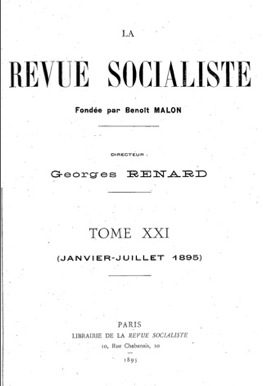1895-1896. Jaurès publie, dans la Revue socialiste, sous le titre général L’organisation socialiste une série de cinq textes : 1. Collectivisme et radicalisme. 2. L’Etat socialiste et les fonctionnaires. 3. L’Etat socialiste et l’Etat patron. 4. Esquisse provisoire de l’organisation industrielle. 5. La production socialiste.
Ces textes constituaient pour lui une sorte de première ébauche d’un ouvrage à venir consacré à la révolution sociale et au régime socialiste qui en sortirait.
Texte presque intégral du troisième de ces chapitres : L’Etat socialiste et l’Etat patron.
L’État patron capitaliste
De même qu’on s’imagine, à tort, que les socialistes veulent développer le fonctionnarisme actuel, on s’imagine aussi qu’ils veulent développer et étendre à la production toute entière le patronat actuel de l’État, des départements et des communes. Et alors on nous dit : Quel avantage en résultera-t-il pour les travailleurs ? Est-ce que les ouvriers d’État ou de commune sont plus heureux que les ouvriers de l’industrie privée ? Les femmes, dans les manufactures de tabac de l’État, travaillent dix heures par jour pour un très modeste salaire, et les ouvriers et ouvrières des tabacs en sont encore à organiser des syndicats et une agitation périodique pour arracher à l’État une petite retraite. L’État, qui est patron, résiste comme tous les patrons : il est, lui aussi, un capitaliste, un bourgeois, un exploiteur. De même, dans les arsenaux publics qui fondent et ajustent des canons et des affûts, les ouvriers civils sont assujettis à un rude travail de dix heures pour un salaire médiocre qui n’excède point en tout cas les salaires de l’industrie privée ; ils sont soumis à la même consigne brutale ; cinq minutes de retard entraînent une forte amende ; le travail étant payé à la tâche, ce sont les plus vigoureux qui déterminent le niveau moyen des prix, et là aussi la lutte pour la vie tourne au détriment du plus faible. Toute velléité de réclamation ou d’indépendance y est sévèrement surveillée et réprimée ; il leur a été interdit, par affiche et sous peine de renvoi immédiat, de chômer le jour du 1er mai et de s’associer à la manifestation des huit heures; ils sont renvoyés sans contrôle et aussi sans indemnité ; ils sont soumis, comme tous les prolétaires, aux fluctuations économiques, à la loi de l’offre et de la demande et, quand les travaux extraordinaires d’armement se ralentissent, les ouvriers des arsenaux ou des poudreries sont renvoyés en un jour par centaines. Où est l’avantage pour les travailleurs ? De même, que l’on compare les ouvriers et employés des chemins de fer sur le réseau de l’État et sur les réseaux des compagnies, on verra peut-être que l’État s’interdit à lui-même certains abus de détails, certains surmenages aussi mesquins qu’odieux que se permettent quelques compagnies ; mais dans l’ensemble il administre selon les mêmes principes, il applique le même niveau de salaires, et il essaie, lui aussi, d’amortir et de rémunérer le capital engagé en réduisant au minimum la part des salariés.
De même, quand l’État, les départements ou les communes exécutent des travaux, quand ils construisent ou des voies ferrées, ou des chemins vicinaux, ou des écoles, ou des marchés, ils adoptent, selon les cas, ou la régie ou l’adjudication. Dans les travaux en régie, ils appliquent les conditions générales du travail, ils paient la journée ou l’heure comme elles se paient dans les travaux des particuliers. Avec les adjudications, c’est pire encore : car les entrepreneurs se disputent les entreprises par des rabais souvent exagérés, parfois-insensés ; et ce qu’ils ne peuvent pas ensuite regagner sur la malfaçon, ils le rattrapent sur le salaire des ouvriers ; ils ont des travailleurs au rabais, ils ont même quand l’entreprise est vaste, des rabatteurs qui vont fouiller au fond de toutes les misères pour en extraire le travail à bon marché : ces rabatteurs prélèvent encore une dîme sur le travail ainsi avili, et ainsi la puissance publique, par l’entremise de ses adjudicataires, utilise ce résidu social et aggrave la dépréciation normale du travail. Au reste, en dehors même de ces rabais violents, que gagnent les facteurs ? que gagnent surtout les cantonniers ? Les manouvriers qui, dans les industries privées, sont au plus bas de l’échelle du salariat n’ont rien à envier aux pauvres casseurs de cailloux que l’État majestueux dissémine le long de ses routes triomphales. Et quant aux balayeurs des villes, le salaire qu’on leur alloue ressemble si fort à un secours d’extrême misère qu’on ne leur fait faire parfois que demi-journée pour répartir ce secours sur un plus grand nombre de têtes et déguiser un plus grand nombre d’aumônes.
Donc que les travailleurs peinent pour l’État, les départements, les communes ou pour les particuliers, c’est toujours la même chose : que le patron s’appelle État ou Schneider, c’est-toujours la même dépendance, et la même misère, et si l’organisation socialiste devait être l’extension du patronat actuel de l’État, des services publics de travaux tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui, elle ne serait qu’une immense duperie. […]
L’État reste serf des conditions économiques actuelles
Bien loin que le patronat actuel de l’État soit le type de l’organisation socialiste, il n’existe que parce que l’État, comme producteur, subit les fatalités économiques de la société présente. L’État, les départements, les communes, ne sont en réalité, quand ils veulent produire, que des particuliers soumis à toutes les lois et à toutes les catégories économiques de l’ordre capitaliste, à la concurrence, à l’offre et à la demande, au salariat, à l’intérêt de l’argent.
La société n’ayant pas organisé le travail, l’État, dans la sphère du travail, est subordonné tout comme un entrepreneur privé. Tandis qu’il règle et organise selon son idéal la justice, l’éducation et que là il exerce sa souveraineté, il n’est pas dans l’ordre du travail un souverain, mais un sujet, le sujet des forces aveugles qu’il n’a pas encore disciplinées. C’est ainsi qu’il est obligé de respecter la loi de l’offre et de la demande et de payer, lui aussi, ses ouvriers selon le taux de salaire que déterminent la concurrence des bras et l’état du marché humain : car aucune détermination rationnelle, normale du salaire n’étant instituée, aucune mesure commune de la valeur des produits et du travail n’étant acceptée et promulguée, il procéderait au hasard dans la fixation des salaires, s’il n’acceptait pas ceux que décide la loi de l’offre et de la demande.
De plus, à supposer que l’État, dans la limite des travaux accomplis par lui, pût donner aux travailleurs un salaire normal qui fût la représentation exacte des produits créés par eux, il jetterait du coup dans la société actuelle une perturbation profonde et prématurée : car il appellerait vers ses travaux, par l’appât d’un salaire plus élevé, tous les travailleurs ; ceux qu’il ne pourrait employer se rejetteraient en désespérés vers les travaux moins bien payés de l’industrie privée et ou bien ils se résigneraient à des salaires inférieurs, et une inégalité injustifiable diviserait les travailleurs, les aigrirait et les armerait peut-être les uns contre les autres, ou bien ils arracheraient aussi à l’industrie privée le plein salaire donné par l’État, celui qui représente la rémunération du travail sans aucun prélèvement pour le capital, et alors, le capital n’étant plus rémunéré dans les entreprises privées, l’ordre capitaliste serait violemment aboli sans que l’ordre social nouveau eut été préparé. Ainsi, ou l’exemple donné par l’État ne serait pas suivi, et son action serait insignifiante, la proportion des entreprises publiques aux entreprises privées étant très faible, ou il serait suivi partout, et il entraînerait une révolution immédiate. C’est dire que l’État, comme patron, reste serf des conditions économiques communes tant que subsistera l’ordre social actuel.
[Le salaire minimum et la journée de huit heures] : ces deux articles du programme socialiste sont parfaitement compatibles avec le système capitaliste, et en fait on les verra peut-être appliqués longtemps avant que le capitalisme soit détruit. Ils sont des corrections, non des transformations, et surtout ils sont des points de ralliement et des moyens de groupement pour les forces révolutionnaires, en vue d’ébranlements plus décisifs.
Ainsi, même dans cette voie et s’il y entre le premier, l’État patron n’échappera pas à l’économie actuelle. Il y est engagé et comme pris tout entier par la loi de l’intérêt de l’argent, qu’il subit comme tous les producteurs de la société présente. Il paie les arrérages d’une dette énorme, et il ne peut se procurer de ressources extraordinaires sans contracter, un nouvel emprunt, et sans s’obliger par là même à un nouveau service d’annuités. Dès lors, pour que les entreprises conduites par lui ne lui soient pas ruineuses et accablantes, il est obligé de leur demander l’intérêt du capital engagé qu’il sert lui-même à ses créanciers. C’est ainsi par exemple que, quand il rachète le réseau téléphonique il est obligé de prévoir dans ses recettes le service du capital engagé, et ces recettes, ce n’est pas seulement dans le prix de la marchandise qu’il les trouve, mais aussi dans l’exiguïté forcée des salaires. Il en est de même pour les entreprises qui sans être absolument dirigées par lui sont cependant, comme les chemins de fer, sous sa responsabilité financière. Les compagnies servent un dividende à leurs actionnaires, un intérêt à leurs obligataires, et l’État garantit un minimum de dividende ou d’intérêt. Il est donc intéressé, par les exigences du capital comme tel, à ce que les compagnies exploitent le plus économiquement possible et maintiennent par conséquent tous les salaires au niveau le plus bas.
Ce n’est pas en devenant patron que l’État réalisera le socialisme
Ainsi l’État, tant qu’il n’aura pas brisé par une organisation nouvelle l’engrenage capitaliste, y sera pris comme les producteurs privés : sa main souvent despotique est impuissante contre ces formidables rouages d’acier, et il devient ainsi nécessairement, de fait ou de complicité, un servant de l’ordre social actuel, de la brutale machine qui foule et pressure le travail comme un pressoir à vapeur foule, le raisin, et qui, faisant jaillir la richesse pour les heureux du monde, ne laisse au peuple qu’un stérile résidu de peine et de misère.
Aussi, quand bien même l’État, en France, deviendrait propriétaire des chemins de fer, comme il l’est en Allemagne, ou des mines, dont quelques-unes en Allemagne aussi et en Russie appartiennent à l’Empire, la fatalité économique qui pèse sur le travail ne serait pas conjurée; car pour racheter les chemins de fer et les mines il faudrait emprunter, et pour le service de ces emprunts il faudrait arracher aux travailleurs de la voie ferrée ou de la mine une large part du produit de leur travail : le nom des bénéficiaires serait changé : ils ne s’appelleraient plus des actionnaires ou des obligataires, ils seraient des rentiers d’État, mais le prélèvement serait le même.
Ce n’est pas qu’il ne puisse y avoir intérêt pour l’avènement du socialisme à ce que l’État rachète les chemins de fer ou les mines. Il matera ainsi des oligarchies qui abusent dans l’ordre politique de leur puissance économique et qui contrarient le développement légal de la démocratie. De plus, il pourra être utile d’essayer, même d’une façon grossièrement approximative, le mécanisme de l’organisation socialiste dans les chemins de fer ou les mines. Nous examinerons cela plus tard. Mais, quel que soit l’heureux artifice imaginé par lui, il n’échappera pas à l’ordre économique actuel par des tentatives partielles, et le rachat des chemins de fer ou des mines n’aura quelque portée que s’il est un premier symptôme et comme un commencement d’une transformation universelle.
Ce n’est donc pas en devenant patron que l’État réalisera le socialisme, mais en préparant l’abolition complète du patronat, aussi bien du patronat de l’État que du patronat des particuliers, c’est-à-dire en supprimant les conditions économiques qui rendent possible et nécessaire le patronat sous toutes ses formes, sous la forme publique comme sous la forme privée.
Socialisme et monopoles
D’ailleurs, aujourd’hui, l’État patron ne subit pas seulement les conditions économiques générales, il subit encore de plus des nécessités fiscales ; la production n’est pour lui bien souvent qu’un moyen fiscal, et la production de l’État, comme pour les postes et les télégraphes, pour le téléphone, pour les allumettes, comme on le demande aussi pour l’alcool, affecte la forme d’un monopole. Le monopole étant la suppression d’une des lois économiques de la société actuelle, la concurrence des capitaux, on s’imagine volontiers que le socialisme sera la multiplication des monopoles. Erreur profonde ! car le monopole a un caractère fiscal, le prix de la marchandise est réglé, non par le rapport de la quantité de travail qu’elle contient à la quantité de travail contenue dans les autres marchandises, mais par la volonté arbitraire du législateur. Il n’en sera pas de même dans la production socialiste.
De plus, l’État, précisément parce que le monopole a un caractère fiscal, est obligé de surveiller et de réprimer toute production libre. J’entends par là qu’il se préoccupe moins du progrès industriel que du progrès fiscal, et que des progrès industriels qui bouleverseraient ses recettes peuvent lui être suspects. La production socialiste n’aura nullement le caractère d’un monopole : dans les grandes associations nationales qui s’emploieront à la production il y aura, sous des conditions générales d’équité, place pour une très large autonomie des groupes, et des individus.
Un principe nouveau
Ainsi, pas plus pour la production industrielle que pour la condition du fonctionnaire, il ne faut préjuger de la société future par quelques traits de la société présente. Il n’y aura pas amplification d’un détail ou d’un organe de l’ordre actuel : car ce n’est pas un être vivant qui surgirait, mais une monstruosité inhabile à vivre. C’est faute de comprendre la hardiesse créatrice du socialisme qu’on lui oppose bien souvent des objections puériles.
Il n’ira pas, avec une timidité enfantine et inepte, emprunter à l’ordre actuel un rouage qui ne peut fonctionner qu’avec lui et le grossir en l’isolant. Il ne fera pas d’une pièce de la vieille demeure tout l’édifice nouveau. Il ne prendra pas à la société qui s’écroule ses fonctionnaires hiérarchisés et aplatis, son patronat d’État dur au salarié et compliqué d’aridité fiscale pour bâtir avec ces deux pierres usées la maison fraternelle.
Non, il entend introduire dans la société un principe nouveau et de ce principe dériver en tous sens des applications nouvelles, et les parties même de l’ordre social actuel qui semblent avoir quelque analogie avec l’ordre nouveau et le préfigurer seront transformées comme tout le reste.
–
[les intertitres ne sont pas d’origine, mais ajoutés pour la publication sur ce site]