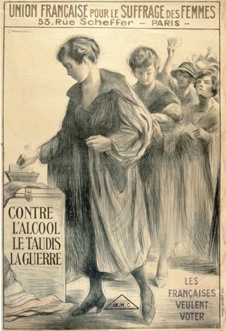Extrait de http://www.leconflit.com/article-feminisme-et-pacifisme-104025224.html dont nous citons ici le passage consacré à la synthèse des travaux de Daniel Armogathe sur les liens entre pacifisme et féminisme au moment de la guerre de 14.
» Daniel ARMOGATHE ordonne les faits pacifistes de féministes (centrés surtout sur la France) selon deux axes croisés : « un axe horizontal ou chronologique rendant compte des « pulsations » de l’activité pacifiste, un axe vertical conduirait du geste individuel ou anonyme à la prise de position publique ou collective ».
Sans remonter très loin dans le temps, il indique les temps forts de ce pacifisme, que nous retrouvons dans d’autres écrits :
– 1878, le Congrès de la Paix de Paris où siègent pour la première fois des lutteuses féministes chevronnées : Hubertine AUCLERT, Léonie ROUZADE et Eugénie NIBOYET ;
– 1897, la fondation de la Ligue de la paix et du désarmement par les femmes, créée par Sylvie Camille FLAMMARION ;
– 1907-1910, les deux conférence des femmes socialistes présidées par Clara ZETKIN, où siègent des Françaises et qui étudient les problèmes de la paix en rapport avec le droit de vote ;
– 1912-1913 : la lutte contre la loi Berry-Millerand (dite « loi des trois ans »), où l’on compte un bon nombre de femmes ;
[ NDLR :
Décrivant la journée du 25 mai 1913, au Pré-Saint-Gervais, où 150 000 personnes se réunirent à l’appel de la SFIO contre la « loi des trois ans » (loi augmentant à 3 ans donc la durée du service militaire), Pierre Clavilier écrit :
» Parmi les orateurs se trouvent Marcel Cachin, les anciens communards Édouard Vaillant et Jean Allemane, mais aussi, et c’est assez rare à l’époque pour le souligner, trois femmes : Maria Verone, Louise Saumoneau et Alice Jouenne. »
Article de Pierre Clavilier, « Il y a un siècle, Jean Jaurès enflammait le Pré-Saint-gervais« …]
– 8 mars 1914 où l’on fête la première fois en France la journée internationale des femmes ;
– Pendant la guerre elle-même, la notion de rythme prend une importance capitale. Le pacifisme démarre lentement dans une France abasourdie, après août 1914, il s’organise en 1915 et pendant la première moitié de 1916 et connaît une accélération soudaine pendant les deux dernières années. Le pacifisme n’est pas le même en 1914 et en 1918, non seulement parce que les sanctions encourues s’aggravent avec l’arrivée au pouvoir de Clémenceau (novembre 1917), mais encore au plan de l’investissement personnel ou collectif que cela suppose. Il faut être une femme considérablement avancée et décidée comme L SAUMONEAU pour se lancer dès août dans une action clandestine et hyper-minoritaire. Même remarque pour ce qui concerne NellyROUSSEL, qui rédige ses premiers articles pacifistes dès le mois de décembre, et pour Madeleine VERNET qui rédige au mois d’août un appel à la paix que les imprimeurs du journal Rénovation refuseront de publier. En réalité, beaucoup de militantes alors en vue ne peuvent qu’interroger leur hébétude, comme le fait Madeleine PELLETIER, dans son Journal de guerre inédit ou, impuissantes, remâcher comme SÉVERINE, une colère « à blanc » ().
Il complète ce tableau :
– octobre 1914, révocation de l’institutrice Julia BERTRAND pour « menées défaitistes » (qui déclenchera une forte campagne de soutien) ;
– janvier 1915, diffusion par L SAUMONNEAU de l’appel de Clara ZETKIN, « Aux femmes socialistes. Pour la Paix » ;
– mars 1915, Conférence des femmes socialistes à Berne, d’où la même L SAUMONNEAU rapporte un manifeste : « Le monde crache le sang ! » dont la diffusion lui vaudra de connaître la prison ;
– avril 1915, le Congrès international des femmes de La Haye (1136 femmes de 12 pays), moment « honteux » pour le féminisme français, puisque les principaux groupes décident de ne pas envoyer de déléguées à cause de la présence des femmes allemandes. Un petit groupe de dissidentes y envoyèrent toutefois une motion, non lue sur place, et dont Romain ROLLAND a sauvé le texte. Ce congrès vit aussi la fondation de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, dont la branche française comptera pendant la guerre une centaine de membres et sera animée par Gabrielle DUCHÊNE ;
[ NDLR :
A ce sujet, extrait de « Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre » (Françoise Thébaud) :
« Il existe aussi un pacifisme féminin plus politique qui s’exprime notamment au congrès international de La Haye pour la paix future, congrès organisé en avril 1915 par la féministe américaine Jane Adams – fondatrice en janvier du Parti de la paix aux États-Unis – et la Hollandaise Aletta Jacobs. Expression d’une communauté des femmes contre la guerre, cette rencontre débat, bien avant les quatorze points du président Wilson, des conditions d’une paix future et permanente (arbitrage obligatoire, respect des nationalités, éducation pacifiste des enfants, suffrage des femmes) et débouche sur un Comité international des femmes pour la paix permanente, qui devient en 1919 la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.
Pour ces féministes, il faut dénoncer le lien entre militarisme et sujétion des femmes, comme l’affirme aussi l’institutrice Hélène Brion, secrétaire générale du syndicat des instituteurs et institutrices, traduite en conseil de guerre pour défaitisme en mars 1918 : « Je suis ennemi de la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale, le féminisme ne peut triompher que par la force morale et la valeur intellectuelle. »
Position minoritaire qui échoue devant la force des nationalismes, comme échoue la minorité des femmes socialistes pacifistes qui se réunissent à Berne en mars 1915, à l’appel de Clara Zetkin. »]
– septembre 1915, la Conférence de Zimmerwald , en Suisse, qui marque la rupture d’une droite pacifiste réformiste et d’une gauche révolutionnaire ;
– janvier 1916, la création du Comité pour la reprise des relations internationales, pépinière de pacifistes féministes, en particulier d’institutrices ;
– à partir d’avril 1917, il faudrait étudier de près les retombées de la Révolution russe, beaucoup de pacifistes, hommes et femmes expriment une sorte de pacifisme (SÉVERINE) qui attend de l’Est la lumière de la paix ;
– les deux dernières années, 1917-1918, pourraient être consacrées à l’examen des affaire judiciaires, celle des époux MAYOUX et, bien sûr le retentisant procès d’Hélène BRION, espèce d’affaire Dreyfus des femmes (Madeleine VERNET).
Sur l’axe vertical, Daniel ARMOGATHE place un pacifisme individualiste, lié à une souffrance personnelle, qui touche par exemple Marianne RAUZE ou un pacifisme éthique catégorique de femmes qui sont pacifistes parce que féministes (Nelly ROUSSEL, Marcelle CAPY), assez indépendant des mouvements syndicaux et politiques.
D’autres au contraire, sont plus proches des mouvements ou des organisations, comme M VERNET, Séverine (pour les libertaires), H BRION, Marianne RAUZE, M PELLETIER, Elisabeth RENAUD, L SOUMONNEAU (socialistes). Cet axe devrait comporter également sur les actes anonymes que signalent des archives départementales : distribution de tracts aux conscrits, blocage de trains, cris séditieux… Sous oublier le rôle obscur dont on ne connaîtra jamais la portée qu’ont pu jouer certaines femmes proches du pouvoir (Mlle de SAINT-PRIX ou la belle-fille de Clemenceau, par exemple).
Amorcé pendant la grande guerre, le pacifisme prend d’autres formes, antimilitarisme, objection de conscience, non-violence, et surtout antifascisme. On constate une approfondissement de la réflexion pacifiste et son extension à des thèmes sociaux-culturels : mise en garde contre les jouets guerriers et les costumes militaires, réprobation de la chasse…
Ce survol effectué en 1984 indique l’aspect ultra-minoritaire du féminisme pacifiste en même temps qu’une maigre historiographie. Il ya sans doute à écrite un livre sur l’action et la pensée de ce féminisme-là, et nombre de mouvements – féministes ou simplement d’historiennes – commencent seulement à exploiter un matériel riche qui gît encore dans les archives, en France comme ailleurs. »
Article complet sur http://www.leconflit.com/article-feminisme-et-pacifisme-104025224.html