Il est malheureusement assez facile, pour un esprit malhonnête et manipulateur, de faire croire, en isolant de leur contexte quelques citations, que Jaurès serait un nationaliste qui, comme le proclamait une affiche du FN il y a quelques années, « voterait front national » ! Jaurès, en son temps, s’était pourtant plusieurs fois exprimé très clairement sur le « chauvinisme imbécile et bas » de ces « misérables patriotes qui, pour aimer et servir la France, ont besoin de la préférer. »
Et avait à de nombreuses reprises dénoncé « l’antisémitisme et le nationalisme [qui] ont tenté de détourner au profit de la réaction l’idée du socialisme et l’idée de la patrie et ont égaré une partie du prolétariat ».
Quand elles ne déforment pas les convictions de Jaurès, les citations courtes comportent un autre risque : celui de n’être plus que des formules élégantes certes mais assez incompréhensibles. En témoigne bien ces phrases célèbres – l’une des citations les plus publiées de Jaurès : « Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène. »
Nous avons donc choisi ici, plutôt que quelques citations courtes, de rappeler synthétiquement les principales convictions de Jaurès concernant cette question du patriotisme et du nationalisme. Avec à chaque fois quelques extraits permettant de restituer dans leur contexte certaines formules célèbres. Et des liens offrant au lecteur intéressé le chemin pour aller lire l’intégralité d’articles ou de discours consacrés à ces thématiques.
La patrie, l’histoire, l’enfance…
Premier point à rappeler : Jaurès aime son pays, sa région natale – il leur est lié par ce qu’il définit comme « un fonds indivisible d’impressions, d’images, de souvenirs, d’émotions ». Mais il les aime sans chauvinisme, sans esprit de clocher. Il n’est pas de ces « imbéciles heureux qui sont nés quelque part » que déteste aussi Brassens… Il n’a pas besoin (cf. le texte déjà cité au début) de rabaisser les autres pays ou les autres régions pour aimer celui qu’il aime, celle où il a passé son enfance.
Jaurès possède donc cet attachement, affectif, personnel ; qu’il sait être lié aussi à ce que le pays porte de son histoire et des idées qui s’y sont inscrites : en cela, la France est pour lui la nation de la Révolution française…
« 1792 – La patrie est en danger : la patrie, c’est-à-dire la France révolutionnaire ; et cette patrie commune de tous les révolutionnaires, de tous les citoyens qui veulent être libres, tous les révolutionnaires, tous les citoyens ont le devoir de la défendre : ils en ont le droit. »
… la France est pour lui la patrie de la République sociale, de cette République qui contient en elle le socialisme, cette République qui a donné aux citoyens le pouvoir dans l’ordre politique et doit maintenant leur donner le pouvoir et l’autonomie dans l’ordre économique.
Jaurès est également convaincu que tous les hommes ayant partagé une même époque en un même lieu sont liés les uns aux autres par des liens particuliers – ceux qui font de l’homme un animal social, ceux qui permettent à l’individu de devenir humain par le contact avec les autres humains :
«A l’intérieur d’un même groupement […] il y a forcément chez les individus, même des classes les plus opposées ou des castes les plus distantes, un fonds indivisible d’impressions, d’images, de souvenirs, d’émotions. L’âme individuelle soupçonne à peine tout ce qui entre en elle de vie sociale, par les oreilles et par les yeux, par les habitudes collectives, par la communauté du langage, du travail et des fêtes, par les tours de pensée et ces passions communs à tous les individus d’un même groupe que les influences multiples de la nature et de l’histoire, du climat, de la religion, de la guerre et de l’art ont façonné. »
Comme il l’explique dans le chapitre X de l’Armée nouvelle , dont ces lignes sont extraites, ces liens entre les individus créent des forces – des forces qui peuvent s’exprimer lors d’événements heureux (fêtes populaires, etc.) mais des forces qui conduisent aussi aux « entraînements aveugles », au chauvinisme, aux manifestations brutales de l’égoïsme collectif, etc. (Ce seront bien ces forces-là qu’il verra à l’oeuvre et contre lesquelles il en appellera à la Raison, au seuil de la Guerre, dans son éditorial du 31 juillet 1914 : Sang froid nécessaire).
De la patrie à l’internationale
Jaurès pense donc la nation comme indispensable aux individus, comme lieu de socialisation d’abord, comme lieu d’élaboration politique ensuite… En effet, la révolution se prépare concrètement. Jaurès ne croit pas en un parti, en une organisation qui n’aurait jamais rien tenté, proposé, expérimenté, en son propre pays, et prétendrait demain, au réveil d’un Grande soir de Révolution, établir sur le monde entier un nouveau mode de fonctionnement ! (Voir à ce sujet le passage sur l’Icarie, toujours dans le chapitre X de l’Armée nouvelle)
La Patrie n’est pas une idole !
Mais si la patrie est nécessaire, il faut aussitôt rappeler, face au risque d’idolâtrie et de chauvinisme, qu’elle n’est ni une idole ni un absolu !
» Elle n’est pas le but ; elle n’est pas la fin suprême. Elle est un moyen de liberté et de justice. Le but, c’est l’affranchissement de tous les individus humains. Le but, c’est l’individu. Lorsque des échauffés ou des charlatans crient : “La patrie au-dessus de tout”, nous sommes d’accord avec eux s’ils veulent dire qu’elle doit être au-dessus de toutes nos convenances particulières, de toutes nos paresses, de tous nos égoïsmes. Mais s’ils veulent dire qu’elle est au-dessus du droit humain, de la personne humaine, nous disons : Non. Non, elle n’est pas au-dessus de la discussion. Elle n’est pas au-dessus de la conscience. Elle n’est pas au-dessus de l’homme. Le jour où elle se tournerait contre les droits de l’homme, contre la liberté et la dignité de l’être humain, elle perdrait ses titres. […] La patrie n’est et ne reste légitime que dans la mesure où elle garantit le droit individuel. Le jour où un seul individu humain trouverait, hors de l’idée de patrie, des garanties supérieures pour son droit, pour sa liberté, pour son développement, ce jour-là l’idée de patrie serait morte. » (Socialisme et liberté, 1898)
Une fédération de nations libres et amies
Des nations nécessaires quand elles sont légitimes, donc. Et des nations qui, comme les individus, doivent être libres, et égales.
Comme Jaurès le rappelle en 1907 lors d’un meeting parisien : « Hervé dit […] que toutes les patries […] se valent… C’est possible ; mais c’est précisément parce qu’elles se valent qu’aucune n’a le droit d’asservir les autres…
Les anciens disaient : Plaignez l’esclave, car il n’a que la moitié de son âme… Eh bien ! il en est ainsi des nations esclaves, des nations serves : leur âme est mutilée, leur génie est incomplet et nous avons besoin, pour la grande œuvre de libération ouvrière et d’organisation humaine, que tous les cerveaux aient toute leur puissance, que tous les individus aient toute leur force de pensée et que toutes les nations aient leur force originale, leur génie et leur faculté propre de développement. »
Et de même qu’il en est des nations comme des individus, que chaque nation, comme chaque individu, doit être autonome et libre, il en est de l’internationale (des nations) comme de la société (des individus) : elle ne doit pas dissoudre les nations / les individus, elle ne doit pas les soumettre, elle doit être construite par eux pour leur permettre justement de se retrouver, de se connaître, d’échanger, de s’enrichir les unes des autres, dans le respect de la liberté et de l’autonomie de chacun.
Etre ensemble et être soi-même (simul et singulis)
Pour Jaurès, individualisme et collectivisme ne s’opposent pas : le vrai collectivisme, celui qui n’est pas imposé, repose sur les relations librement construites entre des individus autonomes. De même, ne s’opposent pas patriotisme et internationalisme : l’internationalisme reposant sur des relations de droit et de respect entre nations implique des nations autonomes et fortes dans leur identité (pour autant, rappelons-le encore une fois, qu’on conçoit bien l’identité solide comme celle qui n’a pas besoin, pour se sentir forte, d’écraser les autres…).
« De même que l’organisation collective de la production et de la propriété suppose une forte éducation des individus, tout un système de garanties des efforts individuels et des droits individuels, de même la réalisation de l’unité humaine ne sera féconde et grande que si les peuples et les races, tout en associant leurs efforts, tout en agrandissant et complétant leur culture propre par la culture des autres, maintiennent et avivent dans la vaste Internationale de l’humanité, l’autonomie de leur conscience historique et l’originalité de leur génie. » (« Méthode comparée », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, octobre 1911)
Jaurès peut donc conclure par des propos qui, lorsqu’ils sont sortis de leur contexte, sonnent bien souvent comme des formules paradoxales. Notamment le fameux :
« C’est dans l’internationale que l’indépendance des nations a sa plus haute garantie ; c’est dans les nations indépendantes que l’internationale a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène. »
Les ennemis de la patrie
Le patriotisme de Jaurès possède de nombreuses implications sur d’autres aspects de sa pensée, de son action, sur lesquels nous reviendrons par ailleurs. Précisons simplement ici qu’il implique que la patrie se défende, refuse de se laisser asservir.
« J’ai toujours été assuré que le prolétariat ne souscrirait pas, dans l’intimité de son être, à une doctrine d’abdication et de servitude nationale. Se révolter contre le despotisme des rois, contre la tyrannie du patronat et du capital, et subir passivement le joug de la conquête, la domination du militarisme étranger, ce serait une contradiction si puérile, si misérable, qu’elle serait emportée à la première alerte par toutes les forces soulevées de l’instinct et de la raison. »
La patrie doit donc posséder une armée – mais défensive, et populaire. Pour se défendre contre l’ennemi extérieur, s’il attaque.
En n’oubliant pas la défense contre les ennemis intérieurs… Certains insistent beaucoup aujourd’hui, dans la droite ligne des partisans de l’Union sacrée de l’été 1914, sur ce « Jaurès qui aurait défendu la patrie contre les Allemands ». Mais en oubliant généralement d’insister sur le Jaurès qui voulait la libérer de ses ennemis intérieurs, l’arracher « aux maquignons de la patrie, aux castes du militarisme et aux bandes de la finance », autrement dit à tous ceux qui s’en sont encore plus emparé à partir de l’été 1914. Nous y reviendrons dans un prochain article…
Juliette Pellissier.

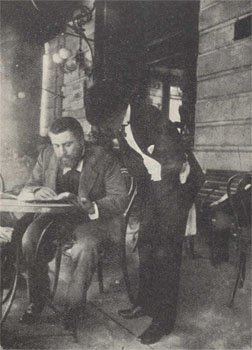
Ping : Le but du socialisme (1901) -