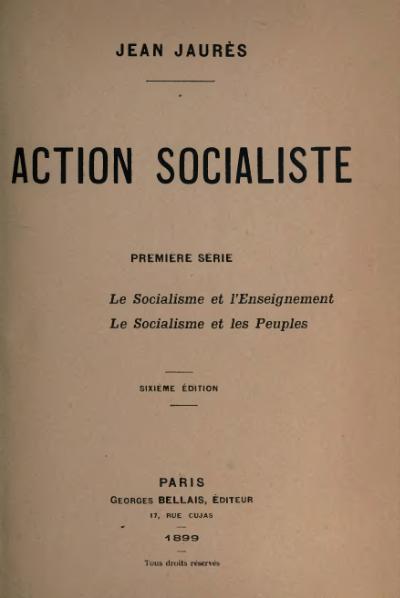La relation Péguy – Jaurès, avec ce passage de l’admiration à la haine, avec ce lien au départ presque filial puis finissant par des appels au meurtre, reste un mystère. Et semble surtout témoigner d’un grand malentendu…
1899. Péguy a 26 ans. En jeune éditeur, en jeune intellectuel et militant socialiste, il édite Jaurès. Et justifie ainsi son choix : « Rare est le vrai poète et le vrai philosophe, celui qui n’ignore pas, qui ne méprise pas le réel, celui qui s’en nourrit, qui en nourrit incessamment son œuvre, celui qui ne devient pas chef d’école, qui ne devient pas chef de parti, qui ne devient pas chef de poètes ou de philosophes ou de partisans, mais qui, resté homme libre, propose à des hommes qui restent libres une œuvre d’art, de poésie, de philosophie, d’action nourrie incessamment de la vie universelle. Nos lecteurs trouveront dans l’œuvre de Jaurès une aussi rare sincérité. »
1913. Péguy prévient : « Dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. »
Entre les deux, quatorze ans. Quatorze ans pour passer d’une sincère admiration à une haine quasi obsessionnelle, pour passer des débats d’idées aux tombereaux d’insultes.
Qu’est-il advenu ? Pour tenter de le discerner, ce qui n’est pas tâche aisée, les différends politiques et philosophiques se mêlant chez Péguy à des considérations personnelles et à une forme de fixation pathologique, distinguons trois périodes.
Jusqu’en 1900 – Jaurès, une figure paternelle
Avant 1900, aucun nuage dans une relation qui n’est pas d’amitié mais, de la part de Jaurès, d’estime, et de la part de Péguy, d’admiration.
Jaurès évoque à quelques reprises ce jeune militant socialiste qui publie (en 1899 puis en 1901) deux anthologies de ses textes et presse dès 1898 les socialistes à s’engager en faveur de Dreyfus : « Nous saluons avec une émotion respectueuse tous ces jeunes hommes, cette élite de pensée et de courage, qui, sans peur, proteste publiquement contre l’arbitraire croissant des porteurs de sabre, contre le mystère dont ils environnent leur palinodie de justice. A ces jeunes hommes, je suis presque tenté de demander pardon pour nos tergiversations et nos lenteurs. » (La Lanterne, 15 janvier 1898).
Péguy, comme nombre de normaliens, admire en Jaurès l’intellectuel et le philosophe – mais aussi le politique. Celui qui s’engage et engage les socialistes dans l’Affaire Dreyfus (le livre de Jaurès, Les Preuves, a joué un rôle moins médiatique que le J’Accuse mais tout aussi essentiel) ; celui qui témoigne, par son parcours, d’un républicanisme et d’un socialisme sincères et incarnés : « Il était lui-même un vivant exemple de ce que peut et de ce que vaut un socialisme ainsi vivifié, ainsi humanisé par la considération respectueuse de l’humanité passée, de toute l’humanité présente et future. Son éloquence, infatigablement alimentée de faits, était inépuisablement aérée de large et de libre philosophie. Traitées par lui, les affaires du socialisme ne cessaient jamais d’être les affaires de l’humanité, d’être des affaires humaines. Comme tous les vrais réalistes, il était profondément philosophe et profondément poète et ces deux grandes qualités se confondaient en lui. »
Les années 1900-1903 – Entre socialistes
Période courte pendant laquelle on voit Péguy se détacher de l’admiration sans réserve qu’il avait jusqu’à présent pour devenir plus critique. Le voilà discutant pied à pied, dans plusieurs de ses textes, certains articles ou certaines conférences de Jaurès (par exemple celle sur l’art et le socialisme). Non sans une certaine dose de mauvaise foi (il caricature notamment les positions de Jaurès, dépeint comme prônant non un « art social » mais un « art socialiste »)… Mais cette époque-là reste sous le signe du débat d’idées. Entre deux conceptions du monde – Péguy, proche de Bergson, ne voit pas la Raison à l’œuvre dans l’histoire comme la voit Jaurès –, entre deux conceptions du socialisme – celui de Jaurès est un processus de transformation de la société présente ; celui de Péguy est un anarchisme individualiste très séparé de la réalité (De la Cité socialiste est une cité idéale)…
Jaurès résume d’ailleurs leur divergence en 1901, dans un article de La Petite République : « Je ne crois pas, malgré les trésors de talent et de sincérité passionnée que Péguy dépense à sa thèse dans les Cahiers de la Quinzaine, qu’il nous suffise, en une sorte d’anarchisme moraliste, de susciter, de conscience individuelle à conscience individuelle, la fierté du juste et du vrai. Il faut forger encore, à l’usage du prolétariat, l’outil de gouvernement et de législation. Il se peut très bien, d’ailleurs, que le premier outil sorti de la forge soit élémentaire et maladroit, souvent réfractaire à notre vouloir. En connaissez-vous, maintenant, un meilleur ? »
Péguy contre Jaurès – 1903-1914
« Rien n’est laid, infertile et singe comme la pauvreté du disciple qui ne s’affranchit pas. » écrivait Péguy en 1900. Péguy désormais va s’affranchir. Et les oppositions philosophiques ou politiques (Péguy semble notamment ne pas digérer pas la manière dont Jaurès relance l’Affaire Dreyfus en 1903 sans le consulter) ne doivent pas masquer la dimension psychique : il semble que Péguy ne peut se détacher de Jaurès qu’en transformant l’admiration en mépris et en haine. Un processus qui se lit déjà dans un texte étonnant, de mai 1903, où Péguy reconnaissant qu’il y avait jadis en lui, lorsqu’il écoutait Jaurès parler, de la soumission et de l’obéissance, en conclut… que Jaurès est un homme de commandement et d’autorité ! Extrait :
« Un grand orateur, un véritable orateur, un orateur de génie dans une assemblée, un Jaurès dans une assemblée, dominant la foule, c’est un roi. Rappelons nos anciennes acclamations, et les sentiments de nos anciennes acclamations. Combien n’y avait-il pas d’autorité de commandement dans la voix du grand orateur, dans son effort, dans son geste martelé, dans son poing de marteau, dans sa phrase de commandement forte et grave. Et surtout combien n’y avait-il pas d’obéissance, de suite et de soumission, honnête mais soumise, dans nos acclamations. »
Et pourtant, nul plus que Jaurès ne possédait, dans ses convictions comme dans sa manière de dialoguer, le souci de la liberté et de l’autonomie. C’est même l’une des caractéristiques de la pensée et de l’action jauressiennes, qui sans cesse l’opposait à nombre de socialistes, que de ne rien vouloir imposer, même la révolution, même les réformes, sans que ce soit le résultat de la compréhension, du choix, du cheminement, libres, de citoyens informés et autonomes. Un souci de l’autonomie de l’autre que Péguy lui-même, encore quelques années auparavant, reconnaissait :
« [J’aurais dit que Jaurès] n’a jamais été, pour personne, un chef d’école, qu’il a toujours procédé par propositions, démonstrations et convictions, jamais par séductions, persuasions ou commandements. […] J’aurais insisté sur cette idée, ou plutôt sur cette hypothèse, que si Jaurès ne devint pas un chef d’école, nous le devons en partie à la culture générale et humaine qu’il avait reçue, à la libre philosophie qu’il avait entendue et enseignée : les chefs d’école sont en général des barbares, des incomplets, des têtes étroites, et des ignorants : s’ils n’étaient pas des ignorants, ils sauraient comme il est vain, comme il est mauvais de vouloir commander à des hommes ; ils sauraient que l’action de la raison est seule efficace et définitive ; ils sauraient que rien n’est faux comme la supériorité d’âge ou de commandement… »
1904 et 1905 apporteront d’autres raisons de discordes : création de l’Humanité sans Péguy (Henri Guillemin estime qu’il tînt profonde rancune à Jaurès de n’être pas parmi les nombreux intellectuels invités à y écrire) ; loi de séparation des églises et de l’État ; Coup de Tanger. Ce dernier événement radicalisera encore plus la rupture. L’obsession de Jaurès pour la paix s’oppose désormais à l’obsession de Péguy pour la revanche. Quand le premier affirme que « la paix en Europe est nécessaire au progrès humain ; et la paix assurée, la paix durable, la paix confiante entre l’Allemagne et la France, est nécessaire à la paix de l’Europe », le second écrit que la France et les Français, « peuple élu » et « humilié depuis 1870 », ont désormais la tâche historique de défendre « toute la liberté du monde » face à la « barbarie germanique ».
Jaurès bouc-émissaire…
Les désaccord d’idées existent évidemment, entre les deux hommes, quant à leur conception de la laïcité, du socialisme, de la patrie, et enflent d’année en année dans l’œuvre de Péguy. Mais il faut pour les saisir aller les chercher dans les passages de ses œuvres où il ne parle pas directement de Jaurès. Car dès que Jaurès est évoqué, il devient difficile de savoir quels sont précisément les désaccords d’idées… tant Péguy, à partir de 1904 et jusqu’en 1914, argumente peu, puis n’argumente plus du tout, mais affirme et insulte.
Ainsi, dès 1904, dans un texte consacré à Madagascar, le ton est donné :
« Le gouvernement de […] Madagascar, cette satrapie […], nous représente assez bien ce que sera le gouvernement de cette France quand le commandement de M. Jaurès nous aura tous courbés ; il fera bon vivre dans la satrapie du satrape Jaurès […].
Chasser tous les citoyens de chez eux et les y remplacer par des émissaires du gouvernement, c’est toute la politique de Jaurès… […]
Tyrannie et favoritisme, le symbole est complet ; tyrannie et autofavoritisme : c’est tout le jaurésisme d’État. […]
Ainsi l’État préfère jeter les enfants à la rue, plutôt que de les laisser dans les écoles particulières; supprimer, et ne pas remplacer : c’est tout le jaurésisme gouvernemental ; c’est toute la politique radicale parlementaire de Jaurès politicien. […]
Le jaurésisme se révèle ce qu’il est, exactement le contraire du socialisme. »
Jaurès devient dès lors le Grand Responsable de toutes les dégradations de la mystique en politique, véritable bouc-émissaire de tout ce que Péguy reproche (en général à juste titre, d’ailleurs) à la modernité et aux socialistes. Ce Jaurès devenu « le moderne parmi les modernes », ce Jaurès a qui tout est attribué, y compris le parlementarisme, le combisme et l’hervéisme, ce Jaurès symbole de toutes les trahisons (la pire étant de « renier, trahir et détruire la France » en la vendant à l’Allemagne), responsable de toutes les chutes (celle de la laïcité en « système d’oppression des consciences », celle du dreyfusisme en « système de turpitude », celle du socialisme en « une excitation des instincts bourgeois »), ne reçoit plus à la fin que des insultes : « démagogue », « fourbe », « satrape », « volumineux poussah », « lâche », « pleutre », « affabulateur », « gros bourgeois parvenu », « traître par essence », « pangermaniste », « grossier maquignon du midi » et, en 1914, pour parachever cette incomplète liste, triste symptôme d’un amour filial renversé, homme à guillotiner ou à fusiller.
Le malentendu
Péguy, visionnaire d’une modernité « qui ne croit plus qu’à rien », spirituellement morte, obsédée par la matière et par l’argent, avide d’avoir et vide d’être ; visionnaire d’un socialisme qui transformera les rêves fraternels d’affranchissement et d’autonomie en un communisme qui cachera derrière son nom un capitalisme d’Etat asservissant. Ce Péguy visionnaire ne le fut clairement pas quand il reprochait à Jaurès d’être le responsable de toutes ces chutes à venir.
Le plus frappant peut-être : à chaque fois qu’on regarde ce que Péguy reprochait à Jaurès, on trouve des reproches très souvent légitimes dans leur objet :
crainte d’un socialisme brimant la liberté de pensée et l’autonomie – « Beaucoup de socialistes s’imaginent que la Révolution sociale consistera sûrement à remplacer le patronat capitaliste par un certain patronat de fonctionnaires socialistes. Je m’imagine au contraire que la révolution sociale consistera sans doute à supprimer le patronat : aussi on me nomme anarchiste. » ;
crainte d’une laïcité remplaçant un dogme par un autre, et la pensée d’église par la pensée d’État ;
crainte d’un internationalisme privant les hommes de tout ancrage ; etc.
Légitimes dans leur objet, donc, mais particulièrement erronés quant à leur cible. Là où l’on attendrait que Péguy s’en prenne à Combes, à Guesde, à Hervé, on trouve Jaurès. Jaurès qui n’a cessé précisément de lutter pour éviter que le socialisme devienne ce que Guesde voulait en faire, que la laïcité soit à l’image de celle de Combes, que l’antipatriotisme tienne lieu, à la Hervé (avant 14), de patrie. Jaurès qui craignait, autant que Péguy, ce qu’il appelait le « socialisme d’Etat » et qui ne cessait de rappeler que « ce n’est pas en devenant patron que l’État réalisera le socialisme, mais en préparant l’abolition complète du patronat, aussi bien du patronat de l’État que du patronat des particuliers, c’est-à-dire en supprimant les conditions économiques qui rendent possible et nécessaire le patronat sous toutes ses formes, sous la forme publique comme sous la forme privée ».
Jaurès qui plaçait au cœur de sa pensée et de son action le principe d’autonomie. Autonomie des citoyens dans le domaine politique comme dans le domaine économique. Autonomie des hommes dans le domaine de l’éducation et de la culture pour atteindre au cœur : l’autonomie de la pensée. « Mais ce qu’il faut sauvegarder avant tout, ce qui est le bien inestimable conquis par l’homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats, c’est cette idée qu’il n’y a pas de vérité sacrée, c’est-à-dire interdite à la pleine investigation de l’homme ; c’est cette idée que ce qu’il y a de plus grand dans le monde, c’est la liberté souveraine de l’esprit ; c’est cette idée qu’aucune puissance ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir et aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine ; cette idée que l’humanité dans l’univers est une grande commission d’enquête dont aucune intervention gouvernementale, aucune intrigue céleste ou terrestre ne doit jamais restreindre ou fausser les opérations ; cette idée que toute vérité qui ne vient pas de nous est un mensonge ; que, jusque dans les adhésions que nous donnons, notre sens critique doit rester toujours en éveil et qu’une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées ; que si l’idée même de Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait, visible, sur les multitudes, le premier devoir de l’homme serait de refuser l’obéissance et de le traiter comme l’égal avec qui l’on discute, mais non comme le maître que l’on subit. »
En fin de compte, c’est-à-dire à lire réellement Jaurès sans prendre pour argent comptant ce que Péguy lui reproche, le plus frappant en cette affaire, c’est que Jaurès fut beaucoup plus Péguyste que celui-ci le croyait – et que Péguy était bien plus jauressien qu’il aurait pu l’admettre.
Le mystère Péguy-Jaurès
Certes, des différents politiques, spirituels, philosophiques. Et une supposée incompatibilité entre le socialisme anarchisant et individualiste du poète (dont on pourrait dire ce que Péguy disait du kantisme, qu’il « a les mains pures, mais qu’il n’a pas de mains ») », et le socialisme réaliste, en construction, rassembleur, du directeur de journal, du directeur de parti.
Certes, des différences de caractère. Profondes. Un Péguy pessimiste, sombre, qui aime la polémique jusqu’à la provoquer et l’attiser ; un Jaurès optimiste, qui n’aime rien tant que trouver, entre deux pensées, entre deux œuvres, quitte à les tordre un peu parfois, les points où elles s’accordent et s’enrichissent.
Mais ces différents et différences suffisent-elles à expliquer l’étrange destin de la relation Péguy – Jaurès ?
Ajoutons-y au moins ce que Péguy confie dans l’une de ses œuvres : « En ce temps-là, au temps de Ronsard, Jaurès avait accoutumé de me dire : “Vous, Péguy, vous avez un vice. Vous vous représentez, vous avez la manie d’imaginer la vie de tout le monde autrement que les titulaires eux-mêmes n’en disposent. Et d’en disposer à leur place, pour eux.” » Et, pourrait-on ajouter, de leur reprocher de ne pas se conformer à ce que vous aviez imaginé pour eux. Péguy, qui avait reproché à Dreyfus de n’être pas assez dreyfuysard, et qui n’a cessé de reprocher à Jaurès de trahir le Jaurès qu’il avait aimé… Péguy qui peut-être ne pouvait juger fidèles que ces personnes – Eve, Jeanne d’Arc… – qui le laissaient libre de les imaginer agir, penser et parler à sa manière. Péguy poète, Péguy démiurge, Péguy autonome et libre mais finissant par ne plus supporter que les autres le soient autant que lui…
Il est heureusement d’autres cheminements. Laissons Péguy – le Péguy de 1902 qui n’avait pas encore eu besoin, pour s’affranchir, de détruire –, justement, nous en décrire un : « Quand j’éditai, en 1899, ces anciens articles [de Jaurès], je ne pensais pas, je ne voulais pas présenter au monde une exposition statique du socialisme livresque définitif. Je voulais présenter à ceux qui cherchent, aux hommes sincères et de bonne volonté, un exemple de la droite route qui du républicanisme ordinaire conduit au socialisme, et puisque l’on veut les opposer, au lieu de les distinguer simplement, un exemple de la droite route continue qui de la sincère démocratie républicaine conduit à un socialisme sincère. Il est facile à ceux qui trouvent aisément dans les théories des solutions parfaites aux difficultés théoriques de mépriser ceux qui cherchent péniblement dans la réalité des solutions réelles aux difficultés réelles. Je persiste à penser que dans ce pays nous avons le plus grave intérêt à savoir par quelle voie de progression régulière un véritable républicain s’achemine au socialisme. Et je persiste à penser que Jaurès eut à cet égard un acheminement exemplaire. »
Juliette Pellissier.
Post-scriptum :
Péguy a bon dos
Il est désormais très fréquent, dans les textes concernant l’assassinat de Jaurès, de voir citer les deux passages de l’oeuvre de Péguy où celui-ci appelle en effet au meurtre de Jaurès. Et de ne voir citer que Péguy… Comme si seul Péguy, dans les années 1910-1914, parmi les écrivains, journalistes, hommes politiques, etc., avait lancé de tels appels. Rappelons donc que, les dernières années, ce furent la majorité des journaux et des journalistes, et une très grande partie des intellectuels et des politiques, qui ne cessèrent de calomnier, d’insulter et de clairement affirmer qu’ils préfèreraient le voir mort.
Oui, bien au-delà du seul Péguy, il est clair que l’assassin de Jaurès fut mentalement armé par la majorité de la presse de l’époque et par toute une partie de l’opinion, nationaliste et capitaliste. Celle-là même, d’ailleurs, qui acquitta l’assassin, lors de son procès, en 1919 (tandis qu’elle condamnait à mort, la même année, un anarchiste coupable d’une tentative d’assassinat sur Georges Clemenceau…).
 Une première version de cet article a été publiée dans le hors-série juin-juillet 2014 de Politis consacré à Jaurès et aux grands débats de la gauche depuis Jaurès.
Une première version de cet article a été publiée dans le hors-série juin-juillet 2014 de Politis consacré à Jaurès et aux grands débats de la gauche depuis Jaurès.