Péguy et Jaurès (1) : premières citations de Péguy parlant de Jaurès… avant que l’admiration tourne à la haine. Des citations qui apportent également un témoignage important sur le rôle de Jaurès dans l’Affaire Dreyfus.
Nous proposerons bientôt, sur d’autres pages, les citations de Péguy « contre » Jaurès…
–
Préface à l’édition, par Péguy, du recueil d’articles de Jaurès intitulé « Action socialiste » (1899)
Rare est le vrai poète et le vrai philosophe, celui qui n’ignore pas, qui ne méprise pas le réel, celui qui s’en nourrit, qui en nourrit incessamment son œuvre, celui qui ne devient pas chef d’école, qui ne devient pas chef de parti, qui ne devient pas chef de poètes ou de philosophes ou de partisans, mais qui, resté homme libre, propose à des hommes qui restent libres une œuvre d’art, de poésie, de philosophie, d’action nourrie incessamment de la vie universelle.
Nos lecteurs trouveront dans l’oeuvre de Jaurès une aussi rare sincérité.
—
Dans « Le triomphe de la république » (Cahiers de la quinzaine, janvier 1900)
A mesure que la fête se développait, énorme, la pensée du robuste Jaurès revenait parmi nous. Quand nous chantions : Vive Jaurès ! la foule et le peuple des spectateurs nous accompagnaient d’une immédiate et chaude sympathie. Jaurès a une loyale, naturelle et respectueuse popularité d’admiration, d’estime, de solidarité. Les ouvriers l’aiment comme un simple et grand ouvrier d’éloquence, de pensée, d’action. L’acclamation au nom de Jaurès était pour ainsi dire de plain pied avec les dispositions des assistants.
—
C’est dans « La Préparation du congrès socialiste » (Cahiers de la quinzaine, février 1900) que nous trouvons les plus belles pages que Péguy a consacrées à Jaurès. Des pages où transparaissent, au-delà de l’admiration intellectuelle et politique, de profondes affinités électives. Leur rupture nourrira, dans quelques années, une haine à cette mesure…
La préparation du congrès socialiste, 1900 :
Cette tristesse intérieure à laquelle nous ne devons jamais essayer d’échapper quand nous participons à la lutte des classes est assurément le caractère principal de Jaurès. Non pas que j’oublie l’importance et la puissance de ses autres caractères. Tous les socialistes français et tous les militants socialistes internationaux connaissent la souveraine puissance de celui qu’on nommait malgré soi le grand orateur. Ceux qui l’avaient une fois entendu ne pouvaient l’oublier. Il montait à la tribune. Il était si plein de sa pensée que les premières phrases paraissaient venir mal, comme trop bourrées. Puis la lourde et robuste puissance de sa pensée commençait à se mouvoir dans la force d’abord un peu grinçante et dans la puissance un peu sourde de sa parole, qui prenait aux entrailles. Alors il dominait, d’autant plus maître que la foule avait été plus houleuse, d’autant plus large qu’elle se déroulait comme la mer. Et son discours s’imposait, toujours admirablement composé comme une œuvre classique, servi par une voix soudain devenue claire et merveilleusement puissante. Rien d’artificiel, rien d’appris dans la forme. La force de la pensée portait la force de la forme. Le geste surtout n’avait rien de factice. Il n’avait pas les gestes habituels des orateurs, mais des gestes d’ouvrier manuel, enfonçant les idées dans le bois de la tribune, appuyant du pouce pour insister, gestes rudes et lourds instinctivement faits par son épaisse carrure de montagnard cévenol.
Mais ce qui donnait à tout cela une valeur incomparable, c’était le sentiment intérieur que nous avons dit. Autant il avait de joie exubérante et saine, autant la joie florissante s’échappait de son corps, de ses mains et de ses yeux quand il parlait pour convertir, autant ceux qui le connaissaient bien devinaient en lui un arrière-plan de sincère tristesse quand il parlait pour combattre. Jamais il ne s’est profondément réjoui de ces ignominies bourgeoises qui paraissent illustrer la doctrine socialiste et qui paraissent avancer l’heure de la révolution sociale. Sans doute le sursaut d’indignation que donne à tout homme juste le spectacle d’une scandaleuse injustice bourgeoise pouvait lui sembler un
facteur de la révolution sociale. En ce sens il pouvait, dans la fièvre du combat, crier la joie amère qu’il avait à voir la société ennemie s’enfoncer ainsi dans sa pourriture et précipiter sa propre ruine. Mais comme on sentait bien que cette joie de fièvre et d’amère indignation n’était pas entière, n’était pas son habituelle et innocente joie de convertisseur !
Cette même culture générale, cette même philosophie qui l’avaient conduit au socialisme l’avaient heureusement prémuni contre toute joie mauvaise. Il savait discerner le mal qui se cache sous un tel semblant de bien. Il savait que les ignominies bourgeoises en définitive s’exercent contre la douloureuse humanité, contre l’humanité commune, et qu’ainsi ce qui en définitive est compromis, c’est l’héritage même du socialisme futur, du socialisme prochain.
Il savait que ces ignominies sont toujours exercées sur des hommes vivants, et que, si elles semblent justifier certaines formules non vivantes, elles risquent de détériorer sans remède l’humanité même. Il savait que ce n’est pas avec des livres, avec des textes, mais avec des hommes que se fera la cité socialiste, et qu’elle ne se ferait pas si les hommes étaient irrémédiablement avilis et stérilisés dans la société bourgeoise. Il savait bien qu’il n’y a pas deux humanités, la bourgeoise et la socialiste, mais que c’est la même humanité, qui est à présent bourgeoise, que des individus et des partis socialistes s’efforcent de faire devenir tout entière socialiste. En un mot il n’était nullement scolastique, mais il avait un sentiment, une connaissance exacte et réaliste de la réalité vivante. C’est pour cela qu’il voulait qu’en attendant que la révolution sociale fût parfaite, et justement pour bien faire celte révolution sociale, toute l’humanité devînt et demeurât belle et saine, et digne de sa prochaine fortune.
Il était lui-même un vivant exemple de ce que peut et de ce que vaut un socialisme ainsi vivifié, ainsi humanisé par la considération respectueuse de l’humanité passée, de toute l’humanité présente et future. Son éloquence, infatigablement alimentée de faits, était inépuisablement aérée de large et de libre philosophie. Traitées par lui, les affaires du socialisme ne cessaient jamais d’être les affaires de l’humanité, d’être des affaires humaines. Comme tous les vrais réalistes, il était profondément philosophe et profondément poète et ces deux grandes qualités se confondaient en lui. Loin que cette largeur et cette universalité affaiblît sa force révolutionnaire, il y puisait au contraire les éléments premiers de sa conviction, il y trouvait les puissantes bases de son assurance, de sa robustesse, de sa solidité vigoureuse, montrant ainsi que l’étroitesse de la pensée n’est nullement nécessaire à la vigueur de l’action, que la petitesse des vues n’est pas le gage nécessaire de la solidité. Des haines vigoureuses « Que doit donner le vice aux âmes vertueuses« , il n’avait gardé que la vigueur. Quoi qu’il en ait dit parfois, et quoi qu’il en ait voulu croire, il ignorait totalement la haine.
Dans la même oeuvre, quelques pages après, Péguy consacre un long passage à sa vision de l’histoire de l’engagement de Jaurès dans l’Affaire Dreyfus. Nous avons publié ce passage sur cette page : Pourquoi Jaurès intervint-il dans l’Affaire Dreyfus ?
Puis, toujours dans la même oeuvre, quelques pages après, Péguy reparle de Jaurès :
J’aurais d’abord tâché d’expliquer en quel sens et comment j’avais dit que l’éloquence de Jaurès n’était pas classique. J’entendais par là que son geste, son verbe et sa phrase n’étaient pas faits comme on enseigne à les faire dans les classes de rhétorique. Mais, au bon sens du mot, l’éloquence de Jaurès est admirablement classique, en ce sens que l’ordonnance en est rigoureusement et sincèrement régulière, sans aucun de ces faux ornements qui sont les mensonges de la politesse rhétoricienne.
J’aurais longuement insisté sur cette simple constatation : qu’il n’a jamais été, pour personne, un chef d’école, qu’il a toujours procédé par propositions, démonstrations et convictions, jamais par séductions, persuasions ou commandements ; que par conséquent
l’attaque subie au moment du manifeste ne fut pas un coup de rivalité, une émulation de chefs d’école à chef d’école, mais une surprise des scholarques à un homme libre. J’aurais insisté sur cette idée, ou plutôt sur cette hypothèse, que si Jaurès ne devint pas un chef d’école, nous le devons en partie à la culture générale et humaine qu’il avait reçue, à la libre philosophie qu’il avait entendue et enseignée : les chefs d’école sont en général des barbares, des incomplets, des têtes étroites, et des ignorants : s’ils n’étaient pas des ignorants, ils sauraient comme il est vain, comme il est mauvais de vouloir commander à des hommes ; ils sauraient que l’action de la raison est seule efficace et définitive ; ils sauraient que rien n’est faux comme la supériorité d’âge ou de commandement ; ils sauraient que rien n’est laid, infertile et singe connue la pauvreté du disciple qui ne s’affranchit pas. Voilà ce que j’aurais indiqué en terminant mon article.
*
Le conditionnel n’est pas anodin. Péguy indique après ce passage, à son interlocuteur imaginaire, qu’il a renoncé à écrire cet article sur Jaurès… où il aurait dit tout cela… car tout cela n’est plus vraiment exact…
Le vent commence donc, dès 1900, à tourner…
A suivre… : Péguy et Jaurès (2)…

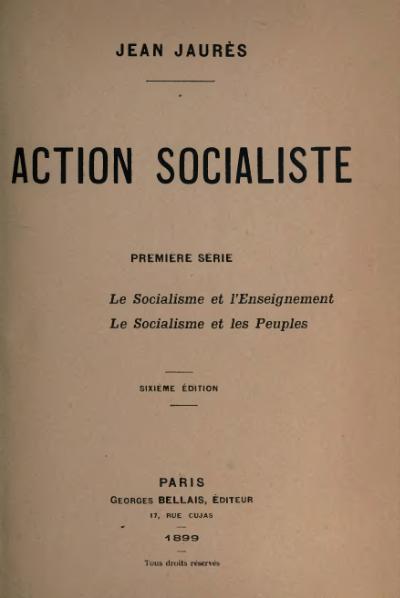

Ping : Pourquoi Jaurès intervint-il dans l'Affaire Dreyfus ? (Péguy) -Jaures.eu