En novembre 1900, lors d’une réunion à Lille, Jaurès revient sur L’Affaire Dreyfus et rappelle les dissensions qu’elle provoqua au sein des socialistes. Ce faisant, il donne aussi là quelques unes de ses plus brûlantes idées sur le rôle du prolétariat et sur le danger du militarisme. [voir aussi la page : L’engagement dans l’Affaire Dreyfus (1898)]
Il y a des heures où il est de l’intérêt du prolétariat d’empêcher une trop violente dégradation intellectuelle et morale de la bourgeoisie elle-même et voilà pourquoi, lorsque, à propos d’un crime militaire, il s’est élevé entre les diverses fractions bourgeoises la lutte que vous savez, et lorsqu’une petite minorité bourgeoise, contre l’ensemble de toutes les forces de mensonges déchaînées, a essayé de crier justice et de faire entendre la vérité, c’était le devoir du prolétariat de ne pas rester neutre, d’aller du côté où la vérité souffrait, où l’humanité criait.
Guesde a dit à la salle Vantier : « Que ceux qui admirent la société capitaliste s’occupent d’en redresser les erreurs ; que ceux qui admirent le soleil capitaliste s’appliquent à en effacer les taches. »
Eh bien, qu’il me permette de le lui dire : le jour où contre un homme un crime se commet ; le jour où il se commet par la main de la bourgeoisie, mais où le prolétariat en intervenant pourrait empêcher ce crime, ce n’est plus la bourgeoisie seule qui en est responsable, c’est le prolétariat lui-même ; c’est lui qui, en n’arrêtant pas la main du bourreau prêt à frapper, devient le complice du bourreau ; et alors ce n’est plus la tache qui voile, qui flétrit le soleil capitaliste déclinant, c’est la tache qui vient flétrir le soleil socialiste levant. Nous n’avons pas voulu de cette flétrissure de honte sur l’aurore du prolétariat.
Il y a deux façons de comprendre la lutte des classes. On peut n’envisager que l’intérêt direct, immédiat et, pour ainsi dire, palpable du prolétariat : l’amélioration des conditions matérielles de son travail, l’élévation de son standard of life.
N’importe quel parti peut y contribuer jusqu’à un certain degré. Tout parti politique, même réactionnaire, surtout dans un pays de suffrage universel, comme la France, peut s’engager à servir les intérêts immédiats et quotidiens du prolétariat. Telle n’est pas la conception du Parti socialiste. Il défend non seulement les intérêts matériels et immédiats de la classe ouvrière dans la société capitaliste, mais aussi et surtout ses intérêts généraux et permanents, ses intérêts sociaux, politiques et moraux. Il veut son émancipation intégrale. Il l’élève au-dessus de sa condition de classe exploitée pour lui conquérir celle d’une classe d’avant-garde, d’une classe révolutionnaire. Le prolétariat conscient de son grand et noble rôle historique accomplit ainsi une mission sociale très importante qu’il se donne à lui-même, dans son propre intérêt supérieur et bien compris. D’après cette conception, le prolétariat devient le défenseur né de tous les intérêts généraux et permanents de la société elle-même. Ainsi le prolétariat ne vit plus en dehors de la société, mais dans, par et pour la société, en ce qu’elle a de vivant et de progressif. Le prolétariat devient alors la force par excellence du progrès. Il en a la charge. Il en est la garantie la plus solide. Et il peut dire : Humanitas siim et nihil hiimani milii alienum puto. Le prolétariat annonce alors la venue d’une nouvelle humanité.
Ce qu’il y a de singulier, ce qu’il faut que tout le parti socialiste en Europe et ici sache bien, c’est qu’au début même de ce grand drame, ce sont les socialistes révolutionnaires qui m’encourageaient le plus, qui m’engageaient le plus à entrer dans la bataille.
Il faut que vous sachiez, camarades, comment, devant le groupe socialiste de la dernière législature, la question s’est posée. Quand elle vint pour la première fois, quand nous eûmes à nous demander quelle attitude nous prendrions, le groupe socialiste se trouva partagé à peu près en deux. D’un côté, il y avait ceux que vous me permettrez bien d’appeler les modérés du groupe. C’était Millerand, c’était Viviani, c’était Jourde, c’était Lavy, qui disaient : «Voilà une question dangereuse, et où nous ne devons pas intervenir.» De l’autre côté, il y avait ceux qu’on pouvait appeler alors la gauche révolutionnaire du groupe socialiste. Il y avait Guesde, Vaillant et moi, qui disions : «Non, c’est une a bataille qu’il faut livrer.»
Ah ! Je me rappelle les accents admirables de Guesde lorsque parut la lettre de Zola. Nos camarades modérés du groupe socialiste disaient : « Mais Zola n’est point un socialiste ; Zola est, après tout, un bourgeois. Va-t-on mettre le Parti socialiste à la remorque d’un écrivain bourgeois ? » Et Guesde, se levant comme s’il suffoquait d’entendre ce langage, alla ouvrir la fenêtre de la salle où le groupe délibérait, en disant : « La lettre de Zola, c’est le plus grand acte révolutionnaire du siècle ! »
Et puis, lorsque animé par ces paroles, en même temps que par ma propre conviction, lorsque j’allai témoigner au procès Zola ; lorsque devant la réunion des colonels, des généraux, dont on commençait alors à soupçonner les crimes, sans les avoir profondément explorés, lorsque j’eus commencé à témoigner, à déposer, et que je revins à la Chambre, Guesde me dit ces paroles, dont je me souviendrai tant que je vivrai : «Jaurès, je vous aime, parce que, chez vous, l’acte suit toujours la pensée.»
Et comme les cannibales de l’Etat-Major continuaient à s’acharner sur le vaincu, Guesde me disait : «Que ferons-nous un jour, que feront les socialistes d’une humanité ainsi abaissée et ainsi avilie ? Nous viendrons trop tard, disait-il, avec une éloquente amertume, les matériaux humains seront pourris, lorsque ce sera notre tour de bâtir notre maison.»
Eh bien, pourquoi après ces paroles, pourquoi après ces déclarations, le Conseil national du Parti, quelques mois après, au mois de juillet, a-t-il essayé de faire sortir le prolétariat de cette bataille ? Peut-être, j’ai essayé de me l’expliquer bien des fois, les révolutionnaires ont-ils trouvé que nous tardions trop dans ce combat, que nous y dépensions trop de notre force et de la force du peuple ?
Mais qu’ils me permettent de leur dire : Où sera, dans les jours décisifs, l’énergie révolutionnaire des hommes si, lorsqu’une bataille comme celle-là est engagée contre toutes les puissances de mensonge, contre toutes les puissances d’oppression, nous n’allons pas jusqu’au bout?
Pour moi, j’ai voulu continuer, j’ai voulu persévérer jusqu’à ce que la bête venimeuse ait été obligée de dégorger son venin. Oui, il fallait poursuivre tous les faussaires, tous les menteurs, tous les bourreaux, tous les traîtres ; il fallait les poursuivre à la pointe de la vérité, comme à la pointe du glaive, jusqu’à ce qu’ils aient été obligés à la face du monde entier de confesser leurs crimes, l’ignominie de leurs crimes.
Et, remarquez-le, le manifeste par lequel on nous signifiait d’avoir à abandonner cette bataille, paru en juillet, a précédé de quelques semaines l’aveu qu’en persévérant nous avons arraché au colonel Henry. Eh bien, laissez-moi me féliciter de n’avoir pas entendu la sonnerie de retraite qu’on faisait entendre à nos oreilles ; d’avoir mis la marque du prolétariat socialiste, la marque de la Révolution sur la découverte d’un des plus grands crimes que la caste militaire ait commis contre l’humanité.
Ce n’était pas du temps perdu, car pendant que s’étalaient ses crimes, pendant que vous appreniez à connaître toutes ses hontes, tous ses mensonges, toutes ses machinations, le prestige du militarisme descendait tous les jours dans l’esprit des hommes et, sachez-le, le militarisme n’est pas dangereux seulement parce qu’il est le gardien armé du capital, il est dangereux aussi parce qu’il séduit le peuple par une fausse image de grandeur, par je ne sais quel mensonge de dévouement et de sacrifices. Lorsqu’on a vu que cette idole si glorieusement peinte et si superbe ; que cette idole qui exigeait pour le service de ses appétits monstrueux, des sacrifices de générations ; lorsqu’on a vu qu’elle était pourrie, qu’elle ne contenait que déshonneur, trahison, intrigues, mensonges, alors le militarisme a reçu un coup mortel, et la Révolution sociale n’y a rien perdu.
Je dis qu’ainsi le prolétariat a doublement rempli son devoir envers lui-même. Et c’est parce que dans cette bataille le prolétariat a rempli son devoir envers lui-même, envers la civilisation et l’humanité ; c’est parce qu’il a poussé si haut son action de classe qu’au lieu d’avoir, comme le disait Louis Blanc, la bourgeoisie pour tutrice, c’est lui qui est devenu dans cette crise le tuteur des libertés bourgeoises que la bourgeoisie était incapable de défendre ; c’est parce que le prolétariat a joué un rôle décisif dans ce grand drame social que la participation directe d’un socialiste à un ministère bourgeois a été rendue possible.
–
[ Au sujet de l’Affaire Dreyfus, voir aussi :



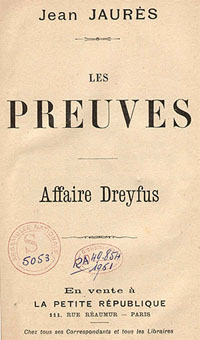
Ping : Le principe de la lutte de classe (1910) -Jaures.eu