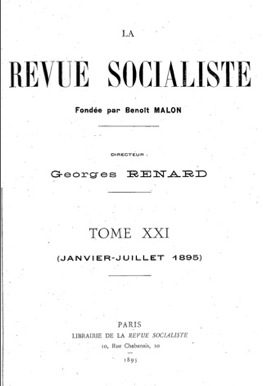1895-1896. Jaurès publie, dans la Revue socialiste, sous le titre général L’organisation socialiste une série de cinq textes : 1. Collectivisme et radicalisme. 2. L’Etat socialiste et les fonctionnaires. 3. L’Etat socialiste et l’Etat patron. 4. Esquisse provisoire de l’organisation industrielle. 5. La production socialiste.
Ces textes constituaient pour lui une sorte de première ébauche d’un ouvrage à venir consacré à la révolution sociale et au régime socialiste qui en sortirait.
Extraits du deuxième de ces textes : L’Etat socialiste et les fonctionnaires, qui se termine par l’une des plus ardentes professions de foi de Jaurès en la liberté.
L’Etat républicain aux mains d’une oligarchie bourgeoise
Il y a une première confusion qu’il faut dissiper. On s’imagine très souvent que le régime de l’État socialiste sera le développement de l’État actuel, c’est-à-dire de la contrainte, de la bureaucratie, des monopoles. Il n’en est rien. Théoriquement, l’État aujourd’hui, surtout l’État républicain, est l’expression et l’organe de la volonté commune et de l’intérêt public. Mais, en fait, il est au service de certaines classes qui ont, selon le hasard des événements ou les lois profondes des sociétés, la prépondérance effective. […]
Aujourd’hui l’État français, après quelques années de hardiesse démocratique, incline visiblement vers la politique conservatrice : il s’inquiète du mouvement ouvrier, et il ne touche à aucune des institutions sociales qui livrent peu à peu les grands capitaux et la puissance économique à une oligarchie bourgeoise. Mais, en même temps, il hésite, malgré quelques douloureux exemples, et peut-être à cause de ces exemples mêmes, à recourir aux répressions violentes.
Ainsi, dans les temps de transition et de préparation où nous sommes, il y a deux forces contraires qui se disputent l’État : il est un instrument à deux fins, qui sert en quelque manière deux classes ennemies, mais il est un instrument : il n’est pas la nation elle-même juridiquement constituée ; il est l’incohérente juxtaposition de nations rivales. Mais, d’une façon générale, depuis un siècle, depuis le demi-avortement de la Révolution française, c’est la classe bourgeoise et capitaliste qui a dominé l’État. Je sais que beaucoup de républicains prétendent que dans la société actuelle il n’y a plus de classes : je n’entends pas instituer en ce moment une discussion là-dessus, et je consens, si on le veut, à ne pas prendre le mot à la rigueur. Assurément, tel prolétaire peut devenir capitaliste et tel capitaliste peut devenir prolétaire : mais il n’y en a pas moins, dans la société française, un groupe d’hommes qui, par une immense supériorité d’éducation, et surtout de fortune que prolonge l’hérédité, ont une influence économique et politique décisive.
[…] J’ai vu de près la manipulation électorale des hommes, et je sais bien des régions où les riches sont en fait les seuls électeurs, où, tout au moins, ils ont un nombre de suffrages très supérieur à celui du pauvre. De même les riches seuls, ou à peu près, sont en fait éligibles. Les paysans et les ouvriers constituent les deux tiers de la nation : il y a dans les Chambres quelques ouvriers à peine et il n’y a pas un seul paysan.
Je me garde bien de dire que l’influence du peuple est nulle, et que rien n’a été fait pour le peuple : ce serait une injustice et une sottise. Je dis seulement qu’il faut que l’influence de la classe possédante soit immense pour qu’elle se marque jusque dans le suffrage universel : il faut que l’inégalité sociale soit bien forte pour qu’elle se prolonge en inégalité politique jusque dans le suffrage universel qui est l’égalité absolue : il est, dans l’ordre politique, la mise en commun de la souveraineté, le communisme complet, et pourtant telle est la force de la propriété qu’elle le façonne à son usage et à son image et qu’elle fait, comme par violence, pénétrer en lui les monstrueuses iniquités qui sont en elle. […]
De l’instruction… mais surtout pas trop !
Les premières victoires et les premières ivresses du parti républicain ont un moment confondu, dans un même élan et une même joie, la bourgeoisie et le peuple, les capitalistes et les prolétaires, les non-possédants et les possédants. De là, les admirables lois, si incomplètes pourtant, d’instruction populaire et la loi sur les syndicats. Ces lois sont des germes, et de ces germes, s’ils se développent librement, sortira l’égalité sociale. Mais pourront-ils se développer et porter leur fruit ? Voilà la question décisive autour de laquelle recommence la bataille de la bourgeoisie et du peuple.
D’un côté, la bourgeoisie comprend que si l’éducation du peuple ne reste pas purement technique et subalterne, si partout, dans les communes rurales et dans les communes urbaines, elle est à la fois professionnelle et libérale, c’est-à-dire humaine, si les ouvriers et les paysans valent autant par l’esprit que les propriétaires et les patrons, l’égalité intellectuelle de tous les citoyens rendra plus flagrante et plus intenable leur inégalité sociale. Le salariat, en effet, est la forme économique de l’ignorance. De là les déclamations contre l’éducation « de luxe » qui ne fait que des déclassés.
De là, malgré le noble zèle de quelques hommes qui ont fait de cette œuvre leur vie même, un ralentissement dans l’œuvre de l’instruction populaire qui est à peine ébauchée : l’esprit public n’est plus passionné à cette grande tâche comme il y a dix ans, non qu’elle soit terminée et qu’on ait droit au repos : mais on sent qu’une instruction plus forte donnée au peuple achèverait l’ébranlement des vieilles iniquités. Dans la partie militante du peuple, au contraire, grandit le sentiment que l’instruction « intégrale » c’est-à-dire humaine, est la condition même de l’émancipation.
Et le peuple transformé transformerait l’ordre social…
Si le parti ouvrier réclame la journée de huit heures, ce n’est pas seulement pour empêcher l’avilissement des salaires en limitant l’offre de travail, c’est encore, c’est surtout pour donner au peuple écrasé le loisir de respirer, c’est-à-dire de penser : car la pensée est vraiment la respiration de l’homme. Les commencements de savoir et de curiosité noble que l’école a suscités chez l’enfant ne seraient plus broyés par le travail démesuré et stupéfiant, comme la graine d’une fleur sous la roue dentée d’une machine, et le peuple transformé transformerait l’ordre social.
De même pour la loi des syndicats. Il n’est ni téméraire ni calomnieux de penser que, si elle était à voter aujourd’hui, le parti gouvernemental ne la proposerait pas. Il veut, autant que possible, en atténuer les effets et en limiter la portée. […] On peut dire dès maintenant que pour la bourgeoisie républicaine, la loi sur les syndicats est une loi suspecte, et, si on osait, une loi condamnée. Le parti ouvrier, au contraire, entend la développer jusqu’à ses conséquences extrêmes. Il veut protéger par des dispositions pénales la liberté des syndiqués contre l’arbitraire patronal. […] Si cela était réalisé, les syndicats ne tarderaient pas à entrer en possession de la puissance économique ; ils seraient représentés dans les Conseils d’administration des grandes sociétés industrielles, et ainsi une part du capital de production deviendrait peu à peu collective.
Donc au bout des réformes votées par la République, au bout de la loi des syndicats comme au bout des lois d’éducation populaire, le socialisme apparaît : il prolonge toutes les avenues ouvertes par la bourgeoisie républicaine. Ce n’est donc plus cette fois sous le couvert des questions politiques que les classes sociales opposées vont lutter entre elle : la question sociale est sortie de toutes les enveloppes où elle sommeillait, et elle éclate sans déguisement.
La lutte entre le capital et le travail
[… La lutte n’est plus exactement entre la bourgeoisie et le peuple] Aujourd’hui la vraie lutte est entre le prolétariat, c’est-à-dire entre ceux, quels qu’ils soient, qui n’ont d’autre ressource que leur travail quotidien, et le capital qui exige comme tel une rémunération. Sans doute, le capital appartient à des personnes, et il est lié plus ou moins étroitement avec leur travail ; mais il apparaît de plus en plus, dans les grandes sociétés anonymes, absolument dégagé du travail ; c’est là qu’il manifeste son essence et sa loi, et on peut dire que la cime du capital émerge de plus en plus, avec ses pentes abruptes et ses arêtes brutales, au-dessus du brouillard où capital et travail sont confondus.
C’est donc le capital comme tel qui domine de très haut et qui dominera de plus en plus notre société ; l’antique opposition de la bourgeoisie et du peuple apparaîtra comme bien anodine auprès de cette forme nouvelle de l’antagonisme social, et on peut dire que la vieille lutte semi-politique et semi-sociale de la bourgeoisie et du peuple a abouti au conflit rigoureusement social du capitalisme et du prolétariat. La lutte n’a pas été atténuée pour cela, au contraire. Elle ne se joue plus autour du cœur, elle ne donne plus aux sociétés des frissons à fleur de peau : elle est dans leurs entrailles mêmes.
La constater n’est pas s’en réjouir. Pour moi, cette permanente opposition des intérêts et des âmes dans l’unité de la patrie me fatigue jusqu’au dégoût, et les socialistes cherchent avec passion le moyen d’y mettre un terme.
L’Etat, gardien armé de la puissance de l’argent
Mais ce conflit profond, inévitable dans l’ordre social actuel, réagit forcément sur la notion et sur le rôle de l’État. Parce que la propriété n’est pas répartie selon la justice, il y a des classes : et parce qu’il y a des classes, l’État est perpétuellement obligé d’user de contrainte. Il est aujourd’hui le gardien de certains intérêts contre d’autres intérêts : et comme, au fond, c’est la puissance de la fortune qui gouverne les sociétés, comme les spoliés et les déshérités ne peuvent lui opposer que la force physique, l’État est incessamment obligé d’écraser ou d’intimider la force physique des masses par la force physique bien supérieure des armées organisées.
S’il n’y avait entre les citoyens que des conflits individuels, comme les querelles de succession ou les rixes après boire, la police et la gendarmerie suffiraient à l’ordre public ; l’intervention permanente de l’armée, à Aubin, à la Ricamarie, à Decazeville, à Fourmies, à Carmaux, atteste bien qu’il y a au fond, dans notre société, une lutte de classes : et c’est parce qu’il y a déchirement de la nation qu’il faut opposer au désordre matériel, signe du désordre économique, la nation elle-même à l’état de discipline et d’unité factice, c’est-à-dire l’armée. Dès lors, l’armée n’a pas seulement pour fonction de protéger la patrie une et indivisible contre la violence de l’étranger. Elle a aussi pour fonction de donner des muscles à la puissance de l’argent, quand l’énergie musculaire du peuple se déploie contre elle.
L’État apparaissant [ainsi] comme une force de contrainte, il semble aux esprits légers que le socialisme, en développant le rôle de l’État, achèvera la servitude des hommes. Ils ne songent pas que l’État socialiste, ayant par hypothèse, aboli les classes par la justice complète et absorbé les antagonismes dans l’unité reconstituée de la nation, n’aura plus besoin de l’armée pour assurer l’ordre intérieur ; l’armée ne sera plus la nation au service d’un ordre factice et violent ; elle sera, si elle subsiste encore, la nation libre et forte tournée vers la frontière pour repousser l’agresseur. […]
L’Etat et le fonctionnarisme
L’État actuel n’est pas seulement écrasé de militarisme, il est surchargé de fonctionnarisme. Et on nous dit : « Vous voulez que l’État devienne commerçant, industriel, agriculteur, et que par suite toutes les formes de l’activité humaine deviennent des fonctions. Nous mourons du fonctionnarisme et vous voulez le développer encore ». En quel sens les producteurs de tout ordre seront des fonctionnaires dans l’État socialiste, nous le verrons plus tard : je me borne à indiquer dès maintenant que la condition générale des fonctionnaires sera absolument transformée. La plupart des défauts présents ou des vices même du fonctionnarisme tiennent au régime actuel des sociétés. Ceux qu’on lui impute, et souvent avec exagération, peuvent se résumer ainsi : arrogance, servilité, stérilité, routine. Or, pourquoi y a-t-il chez certaines catégories de fonctionnaires, des traditions d’arrogance ? Parce qu’ils ont participé longtemps et qu’ils participent encore, en quelque mesure, au pouvoir absolu.
[Jaurès dresse ensuite un portrait des fonctionnaires administratifs et politiques qui ont gardé des temps monarchiques le mépris de la démocratie.]
Ces ingénieurs, qui ne tenaient pas au peuple par le cœur…
Et aussi les ingénieurs de l’État. Un moment, quelques-uns d’entre eux pressentent que le mouvement industriel de notre siècle bouleversera les existences et les sociétés, et qu’il faut le régler et le diriger tout à la fois vers la grandeur matérielle qui est la richesse et vers la grandeur morale qui est la justice : ils se laissent tenter aux idées saint-simoniennes ; et ils pensent au peuple, mais encore en aristocrates de la science et de l’esprit, car ils s’imaginent volontiers que c’est de haut et comme par révélation que le droit nouveau tombera sur les foules. Mais bientôt même cette pensée, à la fois fraternelle et hautaine, est comprimée ou s’éteint ; au pouvoir politique absolu de la bourgeoisie censitaire succède le césarisme ; en même temps que toute liberté meurt, les grands monopoles achèvent de se constituer ; et les ingénieurs qui ne tenaient pas au peuple par le cœur indomptable, mais par l’esprit qui défaille et s’accommode, ne trouvant plus d’ailleurs leur emploi et le vaste essor de leurs formules que dans les grandes entreprises gouvernementales ou capitalistes, se détournent de la démocratie, de ses souffrances oubliées, de ses espérances désormais incomprises, et leur science fait partie du cortège officiel des tyrannies et des oligarchies.
Ils sont les constructeurs de routes de l’empire et ils font planter au besoin des jalons électoraux où ils dressent les horaires des grandes compagnies ; ils sont les calculateurs du pouvoir, les algébristes et les chimistes des grandes sociétés industrielles ; et quant au peuple, qui extrait le charbon, ou raccorde les wagons, ou construit les machines, ou remue la terre à coups de pelletées, ou se brise les os aux échafaudages ambitieux des ponts inédits, qu’il ne trouble pas, par les mouvements désordonnés de son humeur, les calculs savants, les tableaux méthodiques à l’encre rouge et noire et les tracés irréprochables !
[Quant à l’université :] Elle a été l’éducatrice de la bourgeoisie libérale, beaucoup plus que l’initiatrice du mouvement démocratique : et si ce n’est pas elle qui a donné à l’idée de fonction publique quelque chose de hautain et de sénile tout à la fois, elle est restée longtemps une corporation un peu fermée, un peu étroite se régalant de liberté dans Cicéron ou dans Tacite, mais prenant volontiers pour un fracas indiscret et grossier le tumulte des revendications populaires.
Le fonctionnaire de la République
Ainsi, le fonctionnaire tel que l’ont fait depuis un siècle les monarchies, quand il n’était pas despote ou chambellan de despote, était au moins réservé et retiré, et comme étranger à la vie quand il ne la comprimait pas.
Qu’en a fait la troisième République ? Je ne puis dire qu’elle ait sensiblement ennobli, au moins d’une façon générale, l’idée de fonction publique et qu’elle y ait fait entrer à la fois plus de démocratie et plus de liberté. Certes, théoriquement, le fonctionnaire, depuis le préfet et le trésorier général jusqu’à l’instituteur de hameau et au cantonnier, n’est que le serviteur de la souveraineté nationale : il n’est pas à la solde d’une dynastie, d’une famille ou d’un homme, mais de la France libre et maîtresse de soi. Il est l’homme de la nation et de la nation tout entière.
Dès lors il semble qu’il ne doit pas servir des intérêts de classe, mais les intérêts de la nation tout entière : il ne doit penser qu’à elle, aussi bien dans l’exercice immédiat de sa fonction que dans l’usage de la force morale qu’elle lui confère et qui se répand hors de la fonction même. Et si dans cette nation, qui a trouvé sa forme politique, mais qui n’a peut-être point trouvé sa forme sociale, il y a des agitations de pensée et des partis en lutte, si par exemple les faibles, les déshérités demandent une organisation nouvelle du travail et de la propriété, le fonctionnaire, dans l’exercice de sa fonction, doit être d’une absolue impartialité, et, hors de sa fonction, il peut incliner ou se porter même, avec son autorité propre, du côté où son esprit voit le vrai, où sa conscience voit le juste. Il peut considérer comme illégitime un ordre social où les privilégiés voient la formule suprême du droit : il peut aussi considérer et combattre comme des utopies dangereuses les programmes socialistes d’une partie du peuple.
Comme fonctionnaire, il ne relève que de la nation ; comme homme, il ne relève que de sa conscience. Il n’est pas au-dessus des autres citoyens, car il ne peut jamais se servir contre eux, abusivement, de la parcelle de force nationale qu’il a reçue, et il n’est pas au-dessous des autres citoyens ; car, en toutes les questions politiques, sociales et religieuses, il a comme eux une entière indépendance de jugement et de conduite.
Voilà quelle est, si on peut dire, la théorie du fonctionnaire sous un régime vraiment républicain, et si la République existait de fait comme de nom, si la souveraineté nationale était effective, le fonctionnaire ne serait ni oppresseur ni opprimé. Si tous les citoyens usaient du bulletin de vote avec une pleine liberté et une suffisante lumière, s’il n’y avait pas des classes sociales qui par la misère, l’ignorance, la dépendance, la longue habitude de la passivité, sont politiquement inférieures et inertes, aucun gouvernement ne pourrait mettre au service d’un parti les forces administratives, judiciaires, fiscales de la nation et les fonctionnaires ne pèseraient plus sur le pays ; n’étant plus utilisés par le pouvoir, ils ne seraient plus suspectés et menacés par les partis adverses.
La liberté étant en fait garantie à tous et les fonctionnaires n’intervenant plus pour la fausser avec la force de leur fonction, qu’importerait aux hommes les plus passionnés que le fonctionnaire eût et professât telle opinion sur la meilleure organisation des pouvoirs publics, sur la nature de la richesse, sur les droits du travail, sur l’essence du christianisme et sur le problème du monde ? Quand il ne recevra plus des délégations de tyrannie, le fonctionnaire cessera d’être lui-même tyrannisé : quand il ne sera plus un instrument contre la liberté d’autrui, lui-même redeviendra libre.
Comme nous sommes loin de cet idéal ! D’abord les régimes tombés ont légué à la République, dans presque toutes les administrations, un personnel de fonctionnaires rétrogrades qui avaient contracté l’arrogance des antichambres monarchiques : quelques-uns des plus compromis ont disparu : la plupart sont restés. Ils ont, par prudence, baissé la tête, adhéré de parole au nouveau régime. Mais ils étaient humiliés de servir la démocratie et des hommes nouveaux ; ils se sentaient d’ailleurs vaguement suspects, et dans toutes les crises que la République a traversées, ils étaient, d’intérêt comme d’instinct, les complices de la réaction. […]
Il semble donc que l’ensemble des fonctionnaires soit désormais suffisamment pénétré d’esprit républicain et démocratique, et qu’on puisse espérer entre la démocratie républicaine et eux des relations cordiales qui rendent et à la démocratie et à eux-mêmes une entière liberté. Il n’en est rien, et tant qu’une commotion socialiste n’aura pas transformé les conditions générales d’existence, les fonctionnaires seront toujours entraînés ou condamnés à des partialités hautaines contre la démocratie, et toujours soumis en retour aux méfiances oppressives, et au caprice des politiciens.
Un parti nouveau surgi de la démocratie elle-même
D’abord, par l’effet de l’existence des classes sociales, le règne de la démocratie n’est qu’apparent : et c’est bien d’elle qu’on peut dire qu’elle règne et ne gouverne pas. A peine la démocratie a-t-elle triomphé des préjugés monarchiques et des résistances cléricales qu’un parti nouveau surgit de la démocratie elle-même, pour arrêter son élan vers l’égalité sociale. Il y a une nouvelle classe dirigeante, celle de la bourgeoisie républicaine, qui de dirigeante devient peu à peu réprimante et contraignante. Tant qu’il a suffi de belles paroles vagues d’égalité et de fraternité pour amadouer le peuple et amorcer les suffrages, le divorce n’a point apparu. Tant que le peuple, imitant les plébéiens de Rome qui après avoir conquis le droit d’avoir des consuls plébéiens les choisirent longtemps parmi les nobles, tant qu’il ne songea à choisir ses représentants que parmi les privilégiés de l’éducation et de la fortune, les puissants s’abandonnèrent, avec une bonne grâce souriante, au suffrage universel qui les portait. Tant qu’en agglomérant des milliers d’ouvriers dans les grandes industries les capitalistes se bornèrent à ruiner la petite et moyenne industrie, et à constituer des sortes de monopoles lucratifs, ils ne s’effrayèrent pas des concentrations ouvrières.
Mais voici que les travailleurs ne se contentent plus des vagues paroles fraternelles, de l’ombre du nuage qui fuit sur la colline : ils veulent que leurs représentants les représentent, en effet, et les servent : et puisqu’on n’a même pas su ou voulu apporter à leur souffrance de misérables palliatifs, c’est la racine même d’un ordre social inique qu’ils veulent arracher. Voici que pour n’être plus dupés, ils se détournent des dirigeants et commencent à porter dans les assemblées leurs camarades de l’atelier ou de la mine et qu’en bien des points les candidatures bourgeoises sont menacées. Voici que la concentration des travailleurs qui jusqu’ici n’avait enflé que les dividendes fortifie maintenant les espérances du peuple et le peuple lui-même. Des ouvriers avaient été groupés pour mieux développer la richesse de quelques-uns : ils veulent profiter de ce groupement, devenu un accord, pour mieux assurer le bien-être de tous. Dès lors ce qu’on appelle la société, c’est-à-dire les privilégiés de l’ordre social, s’émeut.
Que signifient ces convoitises et ces rêves ? Et alors comme les privilégiée détiennent le pouvoir, comme l’inertie de la plupart des paysans et la dépendance d’une grande partie du peuple le leur livrent pour longtemps encore, comme ils dominent et domineront bien des années dans les assemblées, le gouvernement émané d’eux s’ingénie à arrêter le mouvement social avant qu’il soit organisé, précipité et irrésistible. Et [le gouvernement] tourne contre le parti socialiste toutes les forces organisées de la nation…
[Jaurès donne quelques exemples de la lutte contre les socialistes, les syndicats, etc.]
La force abusive du pouvoir est faite de la faiblesse des citoyens
Mais quoi ! allons-nous reprocher à un gouvernement quelconque d’user de la force publique qui est dans sa main ? Nous n’aurons pas cette naïveté : il n’y a pas, au monde, une seule force disponible qui demeure sans emploi : ceux qui s’en peuvent servir y sont invinciblement portés. Prétendrons-nous que, si la République opportuniste faisait place à la République radicale, la sincérité électorale, l’impartialité administrative, l’indépendance républicaine des fonctionnaires seraient absolues ? Pas davantage : les radicaux abuseraient du pouvoir, et les socialistes aussi en abuseraient, tant qu’ils seraient du moins dans la période de combat, tant qu’ils n’auraient pas, en réalisant leur programme, mis eux-mêmes un obstacle à leurs propres abus.
Ce que nous prétendons, c’est que la force abusive, partiale et oppressive du pouvoir, est faite de la faiblesse des citoyens. Et cette faiblesse a trois causes : l’ignorance, la misère, l’incertitude de la vie. Il n’y a donc qu’un moyen de faire équilibre à la force déréglée du pouvoir, c’est de donner à tous les citoyens toute la force qu’ils peuvent recevoir. Donnez à tous les citoyens l’instruction intégrale : donnez-leur, dans l’immense richesse nationale, une part définie de propriété, d’action, de droit. Donnez-leur, par des organisations de mutualité fraternelle qui naîtront comme d’elles-mêmes de l’état socialiste, la sécurité du lendemain ; et que pourront alors, sur ces citoyens vraiment éclairés et libres, et dont le pain ne sera pas à la merci d’un caprice, les manœuvres oppressives ou corruptives du pouvoir ?
Le socialisme contre la tyrannie (des fonctionnaires, des politiciens…)
[…] De même pour tous les fonctionnaires de tout ordre. Or, comme le socialisme seul en assurant à tout homme une part de propriété assurera à tout homme l’indépendance, comme seul en adoucissant les luttes pour la vie il réservera les loisirs et les forces de l’humanité pour le développement des facultés supérieures, comme seul il abattra les hiérarchies hautaines et cette dépendance des intérêts qui crée la servilité des âmes, seul aussi il affranchira la démocratie des entreprises violentes ou cauteleuses du pouvoir, et il délivrera de leur rôle souvent odieux et triste ceux qui sont aujourd’hui ses instruments, et qui sont parfois ses victimes au point d’être ses bourreaux. Et ainsi, quand on s’imagine que le socialisme, en constituant à l’état de fonction sociale la propriété privée développera ce qu’on appelle le fonctionnarisme et avec lui la servilité et la tyrannie, on oublie que seul il fera disparaître du fonctionnarisme cette servilité tyrannique qui aujourd’hui le déshonore.
De même c’est lui et lui seul qui débarrassera le suffrage universel et les fonctionnaires de la tyrannie des politiciens. Par une contradiction déplorable, le suffrage universel, qui nomme les hommes publics, est bien souvent leur esclave. C’est que la lutte déréglée pour la vie met dans la société un désordre immense. Il n’y a, dans aucune ou dans presque aucune partie du travail humain, une organisation rationnelle. Le droit au travail n’existe pas, et bien des hommes sont perpétuellement en quête d’un moyen d’existence. Ceux qui n’ont pas un capital pour attendre ou ceux qui par imprévoyance et légèreté l’ont dissipé sont à la merci de tous les hasards. Or dans ce désordre, dans cette fluctuation de misères, de désirs, de convoitises, émergent, comme d’innombrables îlots dans une mer semée de naufrages, les fonctions publiques, les unes vastes et fleuries comme les grandes îles, les autres étroites et presque nues comme un rocher, mais où du moins on échappe à l’agitation épuisante et à la détresse infinie. De ces fonctions diverses, nationales, départementales, communales, le nombre est aujourd’hui de plus de 700 000. Et ces fonctions ce sont les partis qui les distribuent, c’est-à-dire les politiciens. Et ce n’est pas seulement sur ces fonctions qu’ils ont en quelque sorte des droits, mais sur toutes les entreprises qui par subvention ou patronage dépendent à un degré quelconque de l’État.
Dès lors, tous ceux qui sont en place tremblent, de peur d’être expulsés, devant le politicien influent, et celui-ci est toujours sûr d’être soutenu contre eux par l’innombrable tribu des remplaçants qui frappent, à grands coups de motions et de délations, à toutes les portes. Le politicien, dans sa sphère d’action, a ainsi un pouvoir presque arbitraire et absolu : ou, s’il ne l’a pas, il aspire à l’avoir et il s’irrite de tous les obstacles : et il contracte ainsi peu à peu, si humble qu’il paraisse, si infime que boit son rôle dans l’ensemble de la vie nationale, tous les vices du pouvoir absolu. Il est despote, il veut être toujours obéi et toujours caressé ; il est ombrageux aussi, pouvant être remplacé demain ; et en tous ceux qui ne sont pas tout à lui il voit des ennemis. Par une confusion inévitable et corruptrice il identifie son intérêt propre et l’intérêt public, et il finit par croire que la satisfaction de ses rancunes, l’assouvissement de ses vengeances et le délire de son orgueil de parvenu font partie de l’ordre républicain.
Contre les tyranneaux de la démocratie
Qu’on ne se méprenne pas sur ma pensée. Ceux qui médisent à fond des « politiciens », des « comités », des « meneurs », sont presque toujours des réactionnaires. Il leur déplaît que tout le pouvoir ne soit pas resté aux grandes influences traditionnelles […]
Pour briser ces tyranneaux de la démocratie, il ne faut pas reculer vers le passé, se serait investir du pouvoir politique les hommes qui ont déjà, par la puissance de l’argent et des situations acquises, le pouvoir social ; ce serait doubler la tyrannie qu’on veut abolir ; ce serait la rendre indestructible en arrêtant le mouvement d’émancipation d’où sortira un jour le mouvement d’organisation qui en supprimant tout désordre supprimera toute tyrannie.
Quand la situation de chacun sera assurée, quand tout citoyen aura, s’il le veut, un travail certain, quand il sera rémunéré selon son travail, quand il s’élèvera par le témoignage de ses compagnons, qu’importeront les intrigues ou les menaces ou les vanités d’un politicien, si même il subsiste encore des politiciens ? Le suffrage universel ne sera plus à la merci de ceux qu’il aura créés : et les fonctionnaires ne seront plus à leur discrétion. Au lieu d’être isolés et plantés comme une cible où toutes les jalousies, toutes les ambitions, toutes les délations vont frapper, ils ne seront qu’une des nombreuses organisations par lesquelles s’exprimera l’activité nationale : et confondus avec l’ensemble des citoyens, ils retrouveront toute leur liberté : les abominables tyranneaux de villages ne les opprimeront plus. […]
Les fonctionnaires dans l’État capitaliste et dans l’État socialiste
De même je n’examinerai pas longuement si l’organisation actuelle des services publics n’est que stérilité et routine : car l’organisation socialiste ne ressemblera que de très loin aux services publics actuels. Je soumets seulement quelques réflexions très brèves. D’abord s’il y a, dans les services municipaux, départementaux ou nationaux, gaspillage par excès de personnel, c’est qu’il y a de toute part une poussée énorme vers les fonctions publiques : et à quoi tient cette poussée ? A ce que ces fonctions, dans l’insécurité absolue de l’existence générale, représentent la sécurité : elles sont le salaire régulier et certain, la retraite assurée pour les vieux jours ; de plus, il n’est pas besoin, pour y entrer, des capitaux qu’exigent l’agriculture, le commerce et l’industrie. Dès lors tous ceux, dans le désordre immense ou nous vivons, qui cherchent un abri ou une certitude, tous ceux qui n’ont pas de capitaux ou qui les ont perdus, soit par leur propre faute, soit par la faute des événements, viennent battre comme un flot toute les digues de tous les budgets, et les emportent. Dans une société où le travail sous toutes ses formes s’offrirait à tous les bons vouloirs, et où partant il y aurait sécurité, ce qu’on appelle les fonctions publiques ne serait plus recherché avec excès, et le travail des citoyens serait réparti et utilisé d’une façon plus productive.
Et encore l’État n’est guère chargé aujourd’hui que des services qui sont ou qui semblent être improductifs. Il a le service de l’armée qui absorbe des milliards sans produire. Il a le service énorme de la dette. Il est obligé de faire mouvoir, à grand renfort de fonctionnaires, l’appareil prodigieusement compliqué des impôts. Il est caporal, policier, gendarme, payeur, collecteur : et même quand il rend des services immédiats, quand il instruit la nation ou quand il transmet les lettres et les dépêches, il n’a qu’un office immatériel, ou bien un office de circulation. Il ne crée pas de la richesse au sens technique du mot. Toute la production proprement dite se fait en dehors de lui : et il semble ainsi frappé de stérilité. Il accomplit pourtant dans l’ordre actuel des fonctions nécessaires, et le jour où la nation interviendra dans la production proprement dite, il apparaîtra bien que le travail national peut avoir une admirable fécondité, avec une autre forme de propriété que la forme actuelle.
Enfin, aujourd’hui, les fonctionnaires sont comme fixés dans une fonction définie et ils suivent comme un mobile engagé dans un rail une ligne inflexible. Sauf quelques exceptions, comme les officiers de marine qui entrent au service de la marine marchande, les ingénieurs de l’État qui entrent au service des grandes compagnies ou les médecins militaires qui ont une clientèle civile, ils sont comme captifs dans leur fonction. C’est que, entre les fonctions publiques et les travaux livrés à l’initiative privée, il n’y a aucune sorte de communication : il n’y a de retraite que dans les fonctions publiques et les quitter, c’est perdre la retraite. De plus l’État est un maître jaloux et il veut qu’on lui appartienne tout entier. Mais le jour où toutes les formes de l’activité humaine seraient en quelque mesure sociales et nationales […], la barrière tomberait : il y aurait entre toutes les fonctions libre passage, libre et incessante circulation ; les aptitudes changeantes ou incertaines des hommes ne seraient pas figées et immobilisées dès la première heure par la fonction choisie d’abord par eux ; les activités seraient perpétuellement en éveil, et même les poussées de sève tardive pourraient s’ouvrir de nouveaux canaux et éclater en floraisons imprévues.
La liberté sera l’âme de l’ordre social rêvé par nous
Chimère ! diront encore une fois les lecteurs pressés. Mais encore une fois il ne s’agit point de cela. Que l’ordre social rêvé par nous soit impossible, nous le discuterons. Mais s’il est réalisable, la liberté aura place en lui, ou plutôt la liberté en sera l’âme même et l’esprit de feu. Si nous allons vers l’égalité et la justice, ce n’est pas aux dépens de la liberté : nous ne voulons pas enfermer les hommes dans des compartiments étroits, numérotés par la force publique. Nous ne sommes pas séduits par un idéal de réglementation tracassière et étouffante. Nous aussi nous avons une âme libre ; nous aussi nous sentons en nous l’impatience de toute contrainte extérieure ! et si dans l’ordre social rêvé par nous, nous ne rencontrions pas d’emblée la liberté, la vraie, la pleine, la vivante liberté, si nous ne pouvions pas marcher et chanter et délirer même sous les cieux, respirer les larges souffles et cueillir les fleurs du hasard, nous reculerions vers la société actuelle, malgré ses désordres, ses iniquités, ses oppressions ; car si en elle la liberté n’est qu’un mensonge, c’est un mensonge que les hommes conviennent encore d’appeler une vérité, et qui parfois caresse le cœur ; ou s’il fallait, par l’élan du rêve, reculer plus haut encore, nous suivrions Jean-Jacques dans les coins de forêt où il se plaît à s’imaginer que nul mortel n’est jamais venu, ou les matelots révoltés de Byron dans la caverne sous-marine où Torquil et Neuha cachent leurs amours indomptés. Plutôt la solitude avec tous ses périls que la contrainte sociale : plutôt l’anarchie que le despotisme quel qu’il soit !
Mais encore une fois, quand on s’imagine que nous voulons créer un fonctionnarisme étouffant, on projette sur la société future l’ombre de la société actuelle. La justice est pour nous inséparable de la liberté.
–
[les intertitres ne sont pas d’origine, mais ajoutés pour la publication sur ce site]